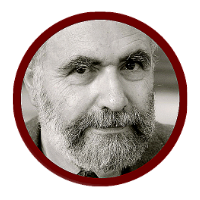Cela fait quarante ans que Riyad lance des « plans de paix » au Proche-Orient. Obama sera-t-il convaincu par le nouveau plan d’Abdallah ?
Le plan de paix saoudien est le serpent de mer de la diplomatie proche-orientale : sa première mouture remonte à 1970. Il est d’ailleurs moins saoudien qu’américano-saoudien. Et son but est moins d’établir une paix durable entre Israël et les pays arabes que de permettre à Washington et Riyad d’occulter les contradictions de leurs politiques étrangères respectives.
Pendant la guerre froide, de 1945 à 1989, l’Amérique avait deux intérêts stratégiques majeurs au Proche et au Moyen-Orient : contrôler le pétrole et le gaz naturel et disposer de bases ou de points d’appui militaires sur le flanc sud de l’URSS. L’alliance avec l’Arabie Saoudite, mise en place par Roosevelt en 1944, semblait constituer à cet égard un atout essentiel. Ce pays était à la fois le "gardien des Lieux Saints" musulmans – La Mecque et Médine – et le premier producteur mondial de pétrole.
Mais l’Amérique était par ailleurs amenée à soutenir pour des raisons idéologiques – la Bible, la démocratie, les droits de l’homme – l’Etat d’Israël, créé en 1948, que les Etats arabes et de nombreux Etats islamiques considèraient comme un ennemi absolu.
Pour compliquer un peu plus le problème, le ralliement de nombreux Etats arabes ou islamiques au camp soviétique – à commencer par l’Egypte de Nasser entre 1953 et 1970 – puis l’essor de l’islamisme extrémiste ont donné à Israël une valeur stratégique qu’il n’avait pas nécessairement à l’origine.
En 1944, l’Arabie saoudite était un pays arriéré et vulnérable. Son intérêt national le disposait donc à une alliance étroite – une symbiose économique et sécuritaire – avec l’Amérique. Mais son idéologie, le wahhabisme, prescrivait le djihad, une lutte permanente et multiforme (allant de l’apostolat à la subversion politique et à la lutte armée) contre l’Occident chrétien et Israël.
Peu à peu, le royaume s’est enrichi. Mais l’alliance américaine est restée nécessaire. Et sur le plan des "représentations", l’obligation idéologique de combattre les civilisations chrétienne et juive n’a rien perdu de son intensité.
En temps normal, les Etats savent concilier ces besoins ou priorités théoriquement inconciliables. Mais en temps de crise, l’affaire est plus ardue. Les opinions publiques, soudain, se réveillent, s’interrogent, accusent. Ils faut répondre à leur attente. D’une façon ou d’une autre.
Dans le cas américano-saoudien, la solution a consisté à lancer des manœuvres diplomatiques où les Saoudiens feraient figure de « modérés » selon les critères occidentaux, et où les Américains, selon les critères islamiques, sembleraient prendre leurs distances avec Israël, ou l’abandonner à son sort.
La première opération de ce type se déroule en 1970, trois ans après la guerre des Six Jours et alors que les Etats-Unis sont englués au Vietnam. Le roi Fayçal d’Arabie Saoudite observe que la paix sera impossible au Moyen-Orient tant qu’Israël ne sera pas revenu aux lignes antérieures à 1967 : le secrétaire d’Etat William Rogers amplifie ces propos et les interprète comme une promesse de paix en cas d’évacuation.
Jérusalem oppose une fin de non-recevoir : la proposition saoudienne est trop vague, et le royaume, de toute façon, n’est pas la principale puissance arabe. Le Congrès américain rejette également le plan Fayçal-Rogers. Car un retrait israélien ne bénéficierait qu’à des alliés de l’URSS : l’Egypte, la Syrie et les confréries terroristes palestiniennes.
Au milieu des années 1970, à la suite de la guerre du Kippour et de la première crise pétrolière, les relations américano-saoudiennes se distendent quelque peu : soudain enrichi, le royaume se rencentre sur son identité wahhabite et donc sur l’idéologie du djihad. Les Etats-Unis croient trouver un allié plus fiable : l’Iran, pays pétrolier musulman mais non-arabe, qui entretient des relations de facto avec Israël. Ils misent également sur l’Egypte, où Anouar el-Sadate, le successeur de Nasser, rompt avec la Russie et s’engage, en 1977, dans des négociations directes avec l’Etat juif.
Mais l’axe Washington-Riyad se reconstitue à partir de 1979, devant une série de crises majeures : la révolution islamique iranienne, la guerre entre l’Iran et l’Irak, la seconde crise pétrolière, l’invasion soviétique en Afghanistan. Le 8 août 1981, le prince héritier d’Arabie saoudite Fahd ibn Abdelaziz lance un second plan de paix. Plus élaboré en que celui de 1970 – pas moins de huit « points » spécifiques – , il ne répond en rien aux attentes des Israéliens. Il y est question d’un « Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale », assorti du « droit au retour des réfugiés arabes » : ce qui revient à nier la légitimité ethnique et religieuse de l’Etat juif ("Si je t'oublie Jérusalem…" – Psaumes, CXXXVII, 5) et à exiger sa dissolution à travers une dilution démographique. Avec une brutalité inouïe, les Américains tentent cependant l’imposer à Israël pendant l’été 1982, à la suite des opérations de Tsahal au Liban. Ils y renoncent quelques mois plus tard, après leur propre déconfiture à Beyrouth face au terrorisme syrien et chiite.
En 2002, un autre prince héritier saoudien, Abdallah ibn Abdelaziz, connu pour ses positions "nationalistes arabes", propose une troisième version dans une interview accordée à un journaliste américain d’origine juive, Thomas Friedmann : paix complète entre les pays arabes et Israël, retour aux lignes de 1967, retour des réfugiés arabes. Objectif de Riyad: redorer un blason de « pays arabe modéré » au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, où presque tous les terroristes étaient saoudiens. Ariel Sharon n’est pas dupe et rejette le document.
Le 1er août 2005, Abdallah devient roi d’Arabie Saoudite. Il relance son plan de paix. En faisant intervenir des restrictions mineures, mais significatives. Les lignes de 1967 pourraient être modifiées ça et là. Et le droit au retour pourrait être restreint à une partie seulement des réfugiés arabes. Sharon prend ce projet de haut. Mais le gouvernement Ehud Olmert, à partir de 2006, manifeste de l’intérêt. Selon les informations dont Hamodia dispose, Olmert l’endosse tel quel. Il se déclare prêt à accepter 100 000 réfugiés – ou réputés tels – en Israël. Tsipi Livni est plus réservée : elle accepte le retour aux lignes de 1967, mais exige que les réfugiés « reviennent » dans l’Etat palestinien, en Cisjordanie ou à Gaza.
Le plan saoudien actuel, comme les précédents, est un produit destiné au marché américain. Barack Obama est-il convaincu ? Ou demandera-t-il aux dirigeants de Riyad d’apporter, s’ils le peuvent, la preuve de leur bonne volonté réelle ?
© Michel Gurfinkiel & Hamodia, 2008