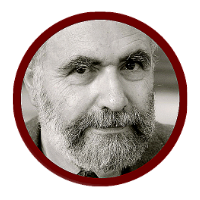Conservateur, thatchérien, reaganien, Stephen Harper a gagné les élections canadiennes le 14 octobre. Voilà qui mérité réflexion et débat.
L’événement est passé presque inaperçu : le14 octobre, le premier ministre conservateur du Canada, Stephen Harper, a été reconduit à la tête de son pays. Mieux, sa majorité s’est étoffée d’une vingtaine de sièges par rapport au parlement sortant, élu en 2006. A un moment où l’on n’entend parler que de la fin de l’ère Thatcher-Reagan, de l’effondrement du néo-capitalisme ou de la chute finale de l’Occident, ce succès dérange les uns et réconforte les autres. Il mérite en tout cas réflexion et débat. Car Harper n’est pas seulement conservateur en paroles. C’est un conservateur en actes.
La crise économique a frappé le Canada comme le reste du monde. Chacun s’attendait à ce que Harper prenne à Ottawa les mêmes mesures que George W. Bush à Washington, ou les Européens à Bruxelles : qu’il sauve le système financier sur des deniers publics. Il a fait le contraire : l’Etat confédéral canadien ne doit garantir, selon lui, que les dépôts des particuliers. Mais pas les banques et les autres institutions financières en tant que telles. Si elles ont fait des erreurs de gestion, ou fraudé, qu’elles paient et au besoin disparaissent. Et que les responsables soient traînés en justice s’il le faut, jusqu’au dernier.
La nation canadienne a entendu ce langage. Le drame de l’Amérique est peut-être que ses propres conservateurs n’ont pas su parler aussi net, ou penser aussi clairement. Un de mes amis, président d’une grande société française installée au Canada, m’a dit que l’erreur de l’administration Bush sortante, face à la crise, a été de justifier, à travers un plan de sauvetage mastodontique ressembant étrangement à une nationalisation, la politique qu’Obama, ou du moins ses conseillers, prétendent mettre en application à partir de 2009. Et que celle de John McCain a été de ne pas prendre suffisamment de distance vis à vis de ce non-sens, qu’il n’approuvait pourtant pas réellement.
Mais au moment suprême, quand l’électeur américain sera seul devant sa machine à voter, sa conscience et son Dieu, les choses se décanteront peut-être. Le conservatisme, ce n’est pas une idéologie, ni même une orthodoxie financière ou économique. Ce sont des valeurs. Bush n’a pas toujours été à la hauteur de sa mission, mais ses valeurs étaient solides. McCain s’est toujours battu pour ses valeurs, de la géhenne vietnamienne aux marigots washingtoniens, même s’il a commis quelques faux pas véniels. Mais Obama ? Que sait-on de lui ? Faut-il croire l’homme qui a caché son enfance musulmane ou celui qui a attendu vingt ans pour rompre avec le pasteur qui l’a converti à un christianisme raciste et révolutionnaire ? Faut-il croire l’homme qui a défendu, en Israël, le caractère israélien de Jérusalem, ou celui qui, le jour suivant, de retour en Amérique, a affirmé qu’on avait mal transcrit ses propos ?
John McCain a pour a ami Steven Harper, qui déclarait en 2007, à l’occasion de la Journée nationale canadienne pour la mémoire de l’Holocauste : « Cela ne suffit pas que des personnalités politiques disent aujourd’hui… qu’il faille garder la mémoire de ce qui s’est passé voici plus de décennies. Il faut que ces personnalités se dressent contre ceux qui, aujourd’hui, se font les avocats de la destruction d’Israël et de son peuple ».
Obama a pour partisan le pasteur et activiste noir américain Jesse Jackson, qui a déclaré à Evian, vingt-quatre heures après la victoire de Harper : « Avec l’élection d’Obama, c’est la fin de décennies où les intérêts d’Israël ont constitué une priorité… et les sionistes vont subir une perte immense ».
© Michel Gurfinkiel, 2008