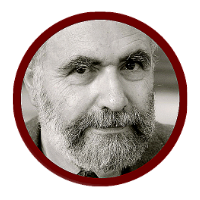Ce qui se dit à la tribune, et ce qu’on voit sur les Champs-Elysées.
Le défilé du 14 juillet 2008 ? Un oxymore. Il n’est question, pendant cette cérémonie, que des droits de l’homme et de la paix. Un artiste, Kad Merad, lit les premières lignes de la Déclaration universelle de 1948. Le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-Moon, siége à la tribune officielle, assis aux côtés du président de la République, Nicolas Sarkozy. Des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement les entourent, pétris de bons sentiments : la plupart viennent de participer à la première réunion de l’Union pour la Méditerranée, qui doit rapprocher les rives nord et sud, l’Occident et l’Orient. Le dictateur syrien, Bachar el-Assad, se tient à quelques mètres à peine de son ennemi Ehoud Olmert, le premier ministre d’Israël. Les deux hommes ne parlent pas en public. Ils l’ont probablement fait en privé.
Mais sur les Champs-Elysées, pendant ce temps, que voit-on ? Des soldats, des armes, des chars. Auxquels répondent, dans le ciel, des avions de combat. La force brute, donc, la guerre, ou du moins leurs instruments. Personne, ni Sarkozy, ni ses hôtes, ni les journalistes qui commentent l’événement, ne semble relever la contradiction. C’est la tradition, pense-t-on. Le 14 juillet, l’armée française défile, et le peuple la complimente. François Mitterrand, en son temps, avait eu l’intuition d’un autre cortège. Pour célébrer le bicentenaire de la révolution de 1789, il avait demandé à Jean-Paul Goude, sur les mêmes Champs-Elysées, une parade toute civile : accordéonistes, danseuses de biguine, mineurs de fond, marins pécheurs, demoiselles de la poste… Goude tira le spectacle vers le surréalisme, et ce fut un franc succès. Pourtant, l’an suivant, Mitterrand régnant toujours sur la France, le défilé fut militaire, à nouveau. Sarkozy, en 2008, joue le classicisme. En dépit du décalage entre ce qu’il dit et ce qu’il montre.
A moins que tout ceci n’ait été voulu. L’oxymore révèle, le plus souvent, une vérité inavouable. En l’occurrence qu’on ne peut discourir du droit et de la paix sans brandir la force. Ou pour être plus net encore, que la force fonde le droit et la puissance militaire, la paix. « Le droit est l’intermède des forces », disait Paul Valéry. Si la France n’était pas encore, en quelque mesure, une grande puissance, une puissance armée, les rois et les présidents ne se soucieraient pas de ses initiatives diplomatiques, si louables qu’elles fussent. Kad Merad, en parlant de la Déclaration de 1948, aurait été dans son vrai rôle, faire rire. Et Assad n’aurait pas fait le voyage de Paris.
© Michel Gurfinkiel, 2008