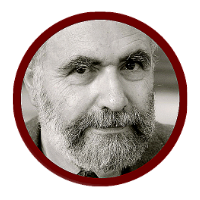Depuis trente ans, James Baker est l'âme du lobby anti-israélien à Washington. Intérêts financiers, obsessions et manigances.Comment définir le " rapport Baker " ? Un monument de perfidie ? Un chef d’oeuvre de sottise ? L’apothéose d’un gentleman cynique et borné ? On a l’embarras du choix.
Rappelons les faits. Début 2006, l’opinion américaine commence à s’interroger sur l’Irak. A juste titre. Et à reprocher à l’administration George W. Bush de conduire les opérations de façon trop souveraine. Certes, le président des Etats-Unis est, selon la lettre de la constitution, le commandant suprême des forces armées et le seul maître de la politique étrangère. Mais l’usage, la coutume, veulent qu’un problème d’une telle gravité fasse l’objet d’un consensus entre les deux partis nationaux, celui qui est au pouvoir et celui qui est dans l’opposition. Surtout quand le parti au pouvoir risque de ne plus y être à brève échéance.
Les républicains dominent encore les deux Chambres du Congrès. Mais les sondages indiquent que les démocrates pourraient se substituer à eux lors des scrutins de la mi-mandat, au mois de novembre 2006. Pour prouver sa bonne foi à l’avance, et se poser, en cas de défaite républicaine, en homme de compromis, le président Bush se résigne donc à accepter la création d’une commission mixte, moitié républicaine, moitié démocrate, chargée non pas d’ " enquêter " sur l’Irak, ce qui supposerait a priori de graves fautes, mais d’ " examiner la situation sur le terrain " . En anglais : " A fact finding commission " .
C’est sur le conseil de son père, l’ancien président George H. W. Bush, dont il ne partage guère les idées par ailleurs, que le président actuel recourt à cette procédure. L’un des principaux collaborateurs de Bush père, James Baker, en est le maître d’œuvre. En théorie, la commission est mandatée par le Congrès, avec l’assentiment de la Maison Blanche. Mais elle est gérée par trois fondations privées. Dont celle de M. Baker lui-même.
Ce dernier est le type même du millionnaire texan sans états d’âme. Le " J. R. " du feuilleton Dallas – pedigree et bonnes manières en plus. Un journaliste américain d’origine libanaise chrétienne, Joseph Farah, directeur du journal internet World Daily News, utilise une image plus fort : " Un souteneur légal au service de l’Arabie Saoudite " (WND, 8 décembre 2006). En anglais : " A legal pimp for Saudi Arabia ".
James Addison Baker III est l’héritier d’un cabinet d’avocats fondé en 1840, à l’époque où le Texas était encore un Etat indépendant, par Peter Gray, le colonel W. B. Botts et le juge James Baker, premier du nom. En 1874, Gray, nommé à la Cour suprême du Texas, vend ses parts à ses associés : le cabinet prend le nom de Baker & Botts. En 2000, il est devenu Baker Botts LLP.
Selon son histoire officielle en ligne (www. bakerbotts.com), ce cabinet travaille d’abord pour les plus grosses fortunes du Texas, issues de l’agriculture latifundiaire : les " rois " du coton, du riz, de la canne à sucre, du bois. Il s’oriente ensuite vers les activités portuaires et les chemins de fer. A partir de 1901, il se spécialise dans le pétrole. Parmi ses clients : " Humble Oil (précurseur d’Exxon), Gulf Oil (qui a intégré Chevron par la suite), Texas Co (aujourd’hui Texaco) ". Sans parler de la compagnie de forage pétroliers d’Howard Hughes, rachetée par la famille Baker et connue aujourd’hui sous le nom de Baker Hughes.
Né en 1930, James Addison Baker III suit dans sa jeunesse le cursus des patriciens : " college " à Princeton, service militaire dans le corps des Marines (il atteint le rang de lieutenant), école de droit de l’Université du Texas, exercice de la profession d’avocat dans un cabinet ami, Andrews & Kurth.
Mais sa passion, c’est la politique. En bon Texan, c’est à dire en Sudiste, il appartient d’abord au parti démocrate : les républicains ayant été pendant la Guerre de Sécession le parti de Lincoln et donc du Nord anti-esclavagiste, les démocrates sont en effet pendant près d’un siècle, des années 1880 aux années 1960, celui d’un Sud vaincu puis restauré, où l’esclavage a été remplacé par la ségrégation raciale.
Mais dans les années 1960, les présidents démocrates John Kennedy et Lyndon Johnson lancent la politique dite des " droits civiques ", qui met fin à la ségrégation et organise l’intégration définitive des Noirs dans la société américaine. Les Blancs du Sud passent alors en bloc au parti républicain. James Baker suit le mouvement.
Dans son nouveau parti, il est d’abord le directeur de campagne de George H. W. Bush, un patricien républicain de Nouvelle-Angleterre transplanté dans le Sud, qui brigue le poste de sénateur du Texas après deux années à la Chambre des Représentants. Cette première expérience tourne court. Bush père avait été dans les années 1960 un partisan de la ségrégation raciale et de la peine de mort pour les " homosexuels récidivistes ". Au seuil des années 1970, il arbore un visage plus modéré, celui d’un " républicain classique ". Cela ne convainc pas les Texans libéraux – y compris l’électorat noir, désormais important. Mais cela l’empêche de mobiliser ses anciens amis d’extrême-droite.
En dépit de cet échec, Bush père et Baker deviennent amis. Ils ont les mêmes sensibilités, les mêmes réflexes. Et les mêmes intérêts dans l’industrie pétrolière texane.
Sa position sociale, ses convictions conservatrices, sa froideur désinvolte, lui valent de devenir sous-secrétaire au Commerce dans l’administration Ford, de l’été 1974 à janvier 1977. En 1978, il tente de se faire élire Attorney General (procureur général) du Texas. Il est battu.
Deux ans plus tard, en 1980, il dirige la campagne de Bush père aux primaires républicaines. Echec, à nouveau : le " républicain classique " est battu par Ronald Reagan, républicain populiste et – déjà – " néoconservateur ".
Sans rancune, ou plutôt soucieux de l’unité du parti républicain, Reagan fait de Bush père son vice-président et, une fois élu, nomme Baker chef de cabinet de la Maison Blanche : un des postes-clés techniques de la nouvelle administration. En 1984, Baker sera le directeur de campagne pour la réélection du tandem Reagan-Bush. Pour la première fois, il réussit. Il est vrai que l’opinion américaine est alors massivement reaganienne, à près de 60 %. A vaincre sans péril…
Baker devient secrétaire au Trésor dans la seconde administration Reagan, de 1985 à 1989. En 1988, il dirige la campagne présidentielle de Bush père. Victoire avec 53,4 % des voix, ce qui représente une petite baisse par rapport au plébiscite de 1984. En fait, la campagne reposait sur un seul argument : votez pour Bush, l’héritier de Reagan. Beaucoup d’Américains ont trouvé cela léger – ou inexact.
En 1989, Bush père nomme Baker secrétaire d’Etat. Le troisième poste officiel dans l’ordre officiel américain, après la présidence et la vice-présidence.
Le premier dossier brûlant qui lui incombe, dès l’été 1989 : la chute du rideau de fer et la désintégration des glacis soviétiques en Europe. Baker minimise l’événement. Deux ans plus tard, à la fin de l'été 1991, il refuse d’admettre que l’URSS elle-même a éclaté en seize Etats indépendants. Quelque chose le pousse à soutenir les régimes " forts ", même rouges. En outre, l’ex-URSS regorge de pétrole et de gaz naturel. Voilà qui intéresse au premier chef les pétroliers texans (le cabinet Baker Botts est présent sur le marché russe depuis les années 1970). Et les incline à la plus grande prudence.
Second dossier : le Moyen-Orient. Là encore, Baker pense et réagit en pétrolier.
Depuis 1945, des liens organiques, symbiotiques, existent entre l’industrie pétrolière américaine et les monarchies pétrolières arabes : l’Arabie Saoudite, mais aussi les émirats du Golfe Persique. C’est là " le plus gros actif de la planète ", comme se plait à répéter le sénateur Barry Goldwater, le gourou de l’aile droite républicaine depuis les années 1960. En anglais : " The biggest piece of real estate in the world ". Les pétroliers américains investissent dans le pétrole arabe, à tous les niveaux : de l’extraction à la commercialisation. Ils servent d’intermédiaires entre les familles régnantes arabes et le pouvoir politique américain. Quand leurs partenaires deviennent vraiment très riches, dans les années 1970, ils les aident à négocier leurs achats aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux : des BTP aux importations d’armes. A chaque niveau ou étape, les commissions et les avantages occultes s’ajoutent aux dividendes de bon aloi. Baker Botts est l’un des représentants juridiques officiels de l’Arabie Saoudite aux Etats-Unis.
Aux yeux des pétroliers et de leurs amis, le soutien américain à Israël est une nuisance, une " erreur " : le nouvel Etat " s’interpose " en effet entre les " partenaires naturels " américains et arabes. Les autres considérations – la survie du peuple juif, les dangers géopolitiques liés au nationalisme arabe ou à l’islam militant – ne les touchent pas.
Certes, la plus grande partie de la classe dirigeante américaine a partagé cette analyse dans les années 1940 et 1950, y compris les " sages " de l’immédiat après-guerre (George Marshall, John Forrestal, Dean Acheson, Averell Harriman, George Kennan, Charles Bohlen, etc). Truman était passé outre, en ordonnant au représentant américain au Conseil de sécurité de voter pour le partage de la Palestine en deux Etats le 29 novembre 1947, puis en reconnaissant Israël le 14 mai 1948. Mais c’étaient là des décisions à la fois personnelles et momentanées, dues à des considérations religieuses (Truman avait été élevé dans le protestantisme évangélique, qui attache une valeur eschatologique au retour des juifs dans leur patrie) ou électorales (se concilier les voix juives lors des élections de l’automne 1948). Elles n’ont pas eu de suite. De 1949 à 1961, pendant la plus grande partie du second mandat Truman et les deux mandats Eisenhower, l’Amérique adopte une attitude froide, sinon hostile, à l’égard d’Israël : pas d’aide économique (à l’exception des dons " charitables " de la communauté juive), pas d’aide militaire (un embargo interdit même à cette époque les exportations de matériel militaire américain vers l’Etat juif), pas de coopération diplomatique (les Etats-Unis imposent l’évacuation immédiate du Sinaï après la campagne de Suez, en 1956).
Mais dans les années 1960 et au début des années 1970, sous les administrations démocrates Kennedy et Johnson, puis sous l’administration républicaine Nixon, Washington entame un rapprochement avec Jérusalem qui finit par conduire à une véritable alliance.
Aux yeux des pétroliers et de leurs amis, le " lobby " le plus puissant du pays, cette " dérive " ne peut s’expliquer que par l’action d’un " lobby juif " au moins aussi puissant : cas classique d’une projection sur l’adversaire de son propre comportement.
La réalité est plus prosaïque : les Etats-Unis se rapprochent d’Israël parce que le " partenariat " américano-arabe ne remplit pas ses promesses. De nombreux pays arabes – le plus important d’entre eux, l’Egypte, mais aussi des pays pétroliers comme l’Irak, l’Algérie ou la Libye – se sont alignés sur l’URSS (dès les années Eisenhower dans le cas de l’Egypte et de l’Irak). D’autres – à commencer par l’Arabie Saoudite – ont pris leurs distances avec les Etats-Unis, notamment en demandant la fermeture des bases américaines. Tous se sont lancés dans une guerre économique contre l’Occident en général et les Etats-Unis en particulier, en menaçant de décréter des embargos sur le pétrole dans le contexte du conflit israélo-arabe, puis, à partir de 1973, en augmentant sans cesse le prix de cette ressource. Pendant l’hiver 1973-1974, l’attitude arabe est si hostile que les Etats-Unis envisagent presque officiellement de se saisir des puits de pétrole du Golfe Persique, y compris en territoire saoudien.
Par contraste, la dimension humaine d’Israël et ses atouts stratégiques ressortent mieux. La montée de l’islamisme, chiite (Khomeini) puis sunnite (Al-Qaida), ne fera que renforcer cette perception, de la fin des années 1970 aux années 1990 et 2000.
Le lobby pro-arabe contre-attaque. La guerre des Six Jours lui fournit une argumentation moins cynique que le seul intérêt pétrolier.
> Au cours de ce conflit, l’Etat juif a pris le contrôle de territoires situés au-delà de la ligne de démarcation établie en 1949, à l’ issue de la première guerre israélo-arabe (la " ligne verte ") : les quartiers Est de Jérusalem, la Cisjordanie et Gaza. Il a également occupé des territoires situés au-delà des frontières internationales de l’ancienne Palestine mandataire : le Golan, le Sinaï. Le lobby pro-arabe affirme que les pays arabes et musulmans, ou du moins " les plus modérés " d’entre eux, feront la paix avec Israël quand celui-ci aura rétrocédé ces conquêtes : " La paix contre les territoires ". La formule frappe par sa simplicité et son apparente équité. En fait, elle permet d’éluder les vraies questions : pourquoi les pays arabes ont-ils refusé le partage de la Palestine en 1947, pourquoi se sont-ils refusé par la suite à reconnaître Israël, pourquoi ont-ils multiplié les agressions à son égard avant 1967, quand il n’occupait aucun territoire situé au delà de la ligne verte, pourquoi ont-il refusé après 1967 une offre israélienne de négociation globale, comment Israël peut-il assurer sa sécurité à long terme contre des agresseurs récidivistes sans la profondeur stratégique assurée par les conquêtes…
> La ligne verte des années 1949-1967 accordait à Israël un territoire plus important et surtout plus cohérent, en termes géographiques et géostratégiques, que celui qui lui avait été attribué par le plan de partage de 1947. Mais pour l’essentiel, elle était conforme à l’idée d’une partition de la Palestine entre deux communautés : les juifs, devenus la nation israélienne, et les Arabes palestiniens, devenus Palestiniens tout court. La guerre des Six Jours modifie cette perception. Dans la mesure où Israël, a posteriori, contrôle désormais l’ensemble de la Palestine mandataire, on peut l’accuser de n’avoir jamais réellement accepté, a priori, le plan de partage. Et même d’avoir prémédité dès l’origine une spoliation complète du peuple arabe palestinien. Ce raisonnement, contraire à la réalité historique, implique qu’un retrait israélien des territoires occupés en 1967 ne suffirait pas à assurer la paix : il faudrait en outre que celle-ci soit " juste ", c’est à dire " rétablir " les Palestiniens dans leurs droits naturels et légitimes – l’indépendance nationale mais aussi le retour des " réfugiés de 1948 " dans leurs " foyers ", situés en-deçà de la ligne verte, dans le " petit Israël " des années 1949-1967.
Ainsi redéfini, le débat entre pro-arabes et pro-israéliens prend une importance exceptionnelle dans la politique américaine. Le Congrès penche vers Israël : en raison de la mobilisation de communauté juive, sans doute, mais aussi, dans un pays qui reste profondément attaché à la Bible et une vision idéaliste de la démocratie, de la plus grande partie de l’opinion publique. Le Pentagone et les milieux stratégiques vont souvent dans le même sens, au fur et à mesure que l’Etat juif fait la preuve de son excellence militaire.
En face, le lobby pétrolier a trouvé des alliés au Département d’Etat, traditionnellement pro-arabe ; dans des milieux marqués par les divers antisémitismes chrétiens, aussi bien protestants que catholiques ou orthodoxes ; et aussi à l’extrême-gauche, où l’ " antisionisme ", dans sa version tiers-mondiste revue et corrigée par Noam Chomsky, devient un dogme.
Au milieu, la Maison Blanche oscille. Lyndon Johnson et Richard Nixon, relativement pro-israéliens, laissent le Département d’Etat mener une politique relativement anti-israélienne. Secrétaire d’Etat à la fin de l’ère Nixon puis sous le républicain Gerald Ford, Henry Kissinger bride ses sentiments pro-israéliens, sauf pendant la guerre de Kippour, en 1973. Le démocrate Jimmy Carter (marqué par l’antijudaïsme baptiste) et son conseiller Zbigniew Brzezinski (marqué par l’antisémitisme catholique, version polono-ukrainienne) sont anti-israéliens. Le républicain Reagan est relativement pro-israélien : mais son entourage comprend à la fois des pro-israéliens convaincus, comme les secrétaires d’Etat Alexander Haig puis George Shultz, et des anti-israéliens résolus, comme le vice-président Bush, le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger et enfin Baker. Rétrospectivement, cette administration apparaît comme pro-israélienne. Mais pendant un bref moment, pendant l’été 1982, elle mènera une politique anti-israélienne d’une violence sans précédent.
En devenant secrétaire d’Etat de George H. W. Bush en janvier 1989, Baker pense être investi d’une mission historique : assurer la victoire définitive du lobby pro-arabe sur le " lobby juif ". Dans le portrait qu’il lui consacre le 13 février 1989, le magazine Time lui attribue une comparaison singulière entre la chasse au faisan et les relations diplomatiques américano-israéliennes : " L’important, c’est de les amener là où vous voulez, aux conditions que vous aurez définies. Dès lors, c’est vous qui contrôlez la situation, pas eux. C’est vous qui avez les options. Qui savez s’il faut appuyer sur la gachette ou non. "
Moshe Arens, qui était à cette époque le ministre israélien des Affaires étrangères puis de la Défense, a décrit en détail dans un livre intitulé Broken Covenant (" Le pacte brisé ") ses relations avec Baker et le plus proche collaborateur, l’amiral Brent Scowcroft, chef du Conseil national de sécurité. Scowcroft, " raide comme un épouvantail ", ne montre " aucun sentiment ni à plus forte raison la moindre sympathie " envers Israël et les juifs. Baker se comporte avec plus de subtilité. Il recourt à la fois aux menaces et aux bonnes paroles. Il sait se montrer tour à tour froid et impénétrable, puis chaleureux et compréhensif. Il attise les dissensions politiques internes d’Israël, en soutenant ouvertement la gauche travailliste et son chef, Shimon Peres, contre la droite, dirigée par Yitzhak Shamir. Il mobilise la presse contre le gouvernement israélien, à travers des " fuites " répétées.
Mais une autre affaire surgit soudain : en août 1990, l’Irak de Saddam Hussein envahit et annexe le Koweit. Les Américains savaient depuis plusieurs mois qu’une telle opération était en préparation, mais n'ont pas réagi avec la vigueur qu’on aurait pu attendre. Pour Baker, le cas est en effet cornélien. Le Koweit, comme les autres monarchies du Golfe, se situe au cœur du partenariat pétrolier américano-arabe. Mais l’Irak est lui aussi un producteur de pétrole de premier plan et semble constituer en outre dans les années 1980, face à l’Iran khomeiniste, le rempart de ces mêmes monarchies. Qui plus est, Baker a "conseillé ", à titre personnel, les deux pays. En définitive, le secrétaire d’Etat a adopté la pire des attitudes : sur ses instructions, l’ambassadrice américaine April Glaspie a laissé entendre à Saddam Hussein, en juillet 1990, que " les Etats-Unis n’avaient pas d’opinion sur le conflit frontalier opposant l’Irak au Koweit ". Ce que le dictateur irakien a interprété comme une ratification implicite du projet d'invasion.
Pendant quelques semaines, Baker tente de dissuader George H. W. Bush de libérer le Koweit par la force : le président américain ne prend finalement une décision allant dans ce sens que sur les recommandations du premier ministre britannique, Margaret Thatcher. Baker opère alors un " mouvement tournant " stratégique et diplomatique : il obtient le ralliement l’autre dictature baasiste, la Syrie, à l’opération anti-irakienne, en lui permettant d’occuper la totalité du Liban, y compris les derniers bastions chrétiens. En d’autres termes, les Etats-Unis autorisent un pays arabe à en subjuguer un autre afin d’interdire à un troisième d’en absorber un quatrième. Il se peut, évidemment, que Baker ait voulu créer, à travers le protectorat syrien sur le Liban, un précédent applicable au Koweit, pour peu que Saddam Hussein renonce à une annexion formelle. Jusqu’au 9 janvier 1991, le secrétaire d’Etat américain négocie avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, dans l’espoir de trouver un compromis.
Voyant que la guerre est inévitable, il donne aux pays pétroliers arabes trois assurances : Israël ne fera pas partie de la coalition internationale qui, sous commandement américain, libèrera le Koweit ; quel que soit le sort de Saddam, les sunnites resteront au pouvoir en Irak ; et une fois le Koweit libéré, la question israélienne sera réglée. Il tient parole. Non seulement Israël est exclu de la coalition, mais on lui interdit de riposter par lui-même quand l’Irak le bombarde avec des missiles balistiques Scud : tout au plus lui prête-t-on des batteries de missiles antimissiles américains Patriot, servies par des personnels américians. Les Occidentaux ne portent pas secours, fin février, aux chiites irakiens que se sont révoltés après la déroute militaire du régime baasiste. Et une conférence internationale sur le conflit israélo-arabe est convoquée à Madrid le 30 octobre 1991.
Dans une telle réunion, plus ou moins calquée sur les " congrès " européens du XIXe siècle, les grandes puissances peuvent facilement créer une sorte d’unanimité contre un petit pays. C’est ce qui s’était passé à Munich, en 1938, quand les " Quatre Grands " (Allemagne nazie et Italie fasciste, Grande-Bretagne et France) avaient disposé de la Tchécoslovaquie. Carter avait déjà esquissé une telle manœuvre contre Israël à l’été 1977, avant d’être pris de court par un subit rapprochement israélo-égyptien, qui avait culminé en novembre 1977 avec la visite du président égyptien Anouar el-Sadate à Jérusalem : Sadate, qui venait de se dégager de l’emprise soviétique, voyait trop bien que la contrepartie d’une conférence internationale aurait été de faire revenir l’URSS au centre du jeu, et ne le souhaitait absolument pas.
Le gouvernement israélien et les milieux pro-israéliens américains se mobilisent contre la conférence de Madrid. George H. W. Bush hésite. Une partie de son cabinet est favorable à Israël : notamment le secrétaire à la Défense, Dick Cheney. Et 1992 sera l’année d’une éventuelle réélection : est-il sage de s’opposer tout de suite au " lobby juif " ? Ne faut-il pas mieux attendre le second mandat ? Baker lui lance alors une phrase célèbre : " Nique les juifs ! De toutes manières, ils ne votent pas pour nous ! " En anglais : " Fuck the Jews. They don’t vote for us anyway ". L’argument même dont se servaient d’autres gentlemen distingués pour refuser d’entrer en guerre contre Hitler avant décembre 1941, ou de bombarder, à l’été 1944, les voies ferrées conduisant à Auschwitz. Bush père y est sensible.
Pour faire plier " les juifs " (ni Bush, ni Baker n’ont jamais été très loin dans les distinctions entre " juifs ", " Israéliens " ou " pro-israéliens "), deux axes : " lier " une aide économique spéciale au profit des immigrants juifs d'origine soviétique qui affluent en Israël – ils seront au total près d’un million – à l’acceptation de la conférence internationale ; et lancer une campagne contre l’ultime garant de la survie nationale israélienne, le " potentiel " nucléaire mis sur pied par l’Etat hébreu depuis les années 1960.
Sur ce second plan, l’entourage de Baker utilise Seymour Hersh, un journaliste gauchiste d’origine juive, prix Pullitzer 1970 pour ses reportages hostiles à l’armée américaine. Hersh a perdu tout crédit pour avoir publié en 1986 un livre (The Target Is Destroyed, Random House) suggérant que les Soviétiques n’étaient pas responsables de la destruction en plein vol, trois ans plus tôt, du Boeing civil sud-coréen KAL 007 transportant deux cents soixante-neuf personnes : une thèse presque aussitôt démolie par les Russes eux-mêmes dans le cadre de la " perestroïka " (Ce livre n’est pas mentionné, aujourd’hui, dans les biographies officieuses du journaliste, notamment celle qui a été mise en ligne sur Wikipedia). Soucieux de rétablir sa réputation, Hersh accepte de rédiger un réquisitoire sur le nucléaire israélien, à partir de dossiers confidentiels qui ont visiblement été fournis avec l’assentiment ou sur l’injonction de l’administration (The Sampson Option, Random House, 1991). Robert Gates, un ami de Baker, est alors à la tête de la CIA.
La campagne anti-israélienne de Bush père et de Baker atteint son sommet le 12 septembre 1991. Ce jour-là, l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac) – le lobby pro-israélien auprès du Congrès – organise une réunion de dirigeants civiques à Washington pour exiger le " découplage " des questions humanitaires et politiques liées à Israël : c’est à dire empêcher un chantage sur l’aide destinée aux juifs de l'ex-URSS. Bush convoque une conférence de presse et veille à ce que la télévision la retransmette en direct. Il se livre alors à la déclaration la plus antisémitique entendue en Occident – au niveau des chefs d’Etat -depuis la petite phrase de Charles de Gaulle, en 1967, sur " un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ".
" Nous sommes confrontés ", dit le président américain, " à des forces politiques puissantes et efficaces, qui ont libre accès au Capitole. Nous n’avons, de notre côté, qu’un petit gars solitaire qui fait son boulot (NDLR : le président)… Mais je me battrai pour mes convictions. Peut-être cela me rendra-t-il populaire, ou peut-être pas… Mais la question n’est pas de savoir si c’est bon pour l’année électorale 1992… Je crois que le peuple américain est avec moi… " La thématique est limpide : pouvoir occulte des juifs, révolte du peuple contre une élite acquise aux juifs.
Bush père va plus loin : " Il y a quelques mois à peine, des hommes et des femmes américains en uniforme ont risqué leur vie pour défendre Israël face aux missiles irakiens Scud (On comprend soudain pourquoi Washington a interdit à Jérusalem de riposter) … et assuré la défaite de l’ennemi le plus dangereux d’Israël… " En outre, " pendant l’année fiscale en cours " et " en dépit des difficultés économiques " qu’ils traversent, les Etats-Unis ont fourni à l’Etat juif une aide d’une valeur totale de 4 milliards de dollars, soit " près de mille dollars par Israélien, homme, femme et enfant ". Derrière ces arguments, c'est un troisième thème de l'antisémitisme radical d'avant 1945 qui est mis à contribution : les Israéliens – et donc par implication les juifs en général – sont des vampires nourris du sang et de l’argent des Gentils, en l'occurence les Américains…
Comme toujours, Baker se trompe. Ces propos révulsent la plupart des Américains. La conférence de Madrid a bien lieu, mais ne débouche sur rien. Un an plus tard, Bush père est battu par le démocrate Bill Clinton, qui affiche sa sympathie pour Israël. Un troisième candidat, le milliardaire Ross Perot, a " gelé " une partie des voix républicaines en se présentant comme un reaganien plus authentique que le président sortant.
Pendant les huit années suivantes – 1993-2001 -, Baker se consacre avant tout à ses affaires : le cabinet Baker Botts et aussi le groupe Carlyle, créé en 1987, dont il est l’un des partenaires. Mais il rêve de jouer à nouveau un rôle politique. En 1997, il accepte une mission de médiateur des Nations Unies au Sahara Occidental, pays annexé par le Maroc en 1975 en dépit du droit international. Il y renonce en 2004, en accusant les parties en conflit (tant le gouvernement marocain que les rebelles sahraouis) d’ " inertie " dans la recherche de la paix. En clair, un échec de plus.
En 2000, la candidature à la présidence des Etats-Unis de George W. Bush, le fils de George H. W. Bush, l’enthousiasme. C’est peut-être l’occasion d’une revanche personnelle sur les démocrates. Et le " lobby juif "… De fait, il joue un rôle non négligeable, en tant que conseiller juridique, dans l’imbroglio créé par le match nul électoral entre Bush fils et le candidat démocrate Al Gore. Ses recommandations aident en particulier les républicains à bloquer un recompte des voix en Floride. Ce qui amène la Cour suprême des Etats-Unis à déclarer Bush vainqueur.
Une fois installé à la Maison Blanche, le nouveau président traite Baker avec déférence. Il le voit, il le consulte. Mais il ne suit pas pour autant ses avis. Chrétien revenu sincèrement à la foi (" born again Christian "), George W. Bush lit la Bible dans la traduction dite du Roi Jacques (" King James ") et voit dans le peuple juif celui de la Promesse. Un voyage privé en Israël, sur l’invitation d’Ariel Sharon, lui a fait une grande impression. En termes idéologiques, il se sent plus proche des néoconservateurs, dans la ligne Reagan-Shultz, que des paléoconservateurs qui entouraient son père. Au sein de son cabinet, il s’appuie sur les néoconservateurs Dick Cheney, devenu vice-président, et Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. Ainsi que sur une amie personnelle au parcours plus complexe, Condoleezza Rice : formée par Scowcroft, initiée au business du pétrole par la famille Bush, cette dernière s’est néanmoins raccrochée au courant néoconservateur.
Baker tente d’infléchir ces orientations " consternantes " . Après les attentats du 11 septembre 2001, il parvient à imposer au président l’idée d’un " découplage " entre l’antiterrorisme américain et celui d’Israël. Fort de ce premier succès, il propose de structurer la stratégie américaine en Afghanistan et en Irak sur le modèle de la première guerre contre Saddam Hussein, en 1991 : en ménageant les susceptibilités arabes et islamiques, en maintenant une position " équilibrée " entre Israël et les Palestiniens, en promettant de réunir à nouveau la conférence de Madrid. A Jérusalem, Sharon dénonce immédiatement la " tentation munichoise " et prévient qu’Israël ne se laissera pas faire. A Washington, les néoconservateurs font remarquer qu’il n’y a pas lieu de ménager des pays tels que l’Arabie Saoudite, dont la plupart des terroristes du 11 septembre étaient originaires. George W. Bush éconduit Baker poliment mais fermement.
L’ancien secrétaire d’Etat ne désarme pas pour autant. A travers ses amis, ses réseaux, les institutions où il est influent, il combat sans relâche les néoconservateurs. La véritable histoire de cette " guérilla " reste à écrire. Elle explique dans une large mesure les blocages et les échecs de l’administration George W. Bush. Elle est à l’arrière-plan des campagnes à caractère médiatique ou judiciaire – quelquefois fondées, le plus souvent infondées – lancées contre des membres éminents de l’administration (l’affaire Plame), des personnalités du Congrès (l’affaire DeLay), des organisations politiques (l’affaire Aipac)…
Dernier acte : la commission sur l’Irak, en 2006. C’est un monument de perfidie vis à vis de la Maison Blanche et du Congrès.
> Perfidie dans le but : chargé d’évaluer la politique de l’administration Bush en Irak, Baker s’emploie à la ruiner.
> Perfidie dans la méthode : en fait de commission bipartisane, Baker met sur pied un groupe de quarante experts où les défenseurs de la politique présidentielle en Irak ne sont qu’une infime poignée, les adversaires nombreux, les personnalités indécises majoritaires – ce qui ne tient compte ni du rapport de forces au sein du parti républicain (trois néoconservateurs de la tendance Cheney-Rumsfeld, en tout et pour tout, seront sollicités), ni même des tendances profondes du parti démocrate. Un des néoconservateurs pressentis, Michael Rubin, démissionne en signe de protestation.
> Perfidie dans le champ d’investigation. Constituée pour enquêter sur l’Irak, la commission s’arroge l’ensemble du Moyen-Orient et se prononce sur l’Iran, sur la Syrie et le Liban, et enfin sur le dossier israélo-arabe, présenté – on s’en serait douté – comme la source première de la crise. La plupart des membres acceptent passivement cette violation du mandat originel : ils sont subjugués par les " grands noms " de la commission, Baker et ses cronies. Un expert – qui a voulu rester anonyme – a déclaré le 26 novembre 2006 à Robin Wright, un journaliste du Washington Post , que la plupart des participants étaient tout particulièrement " fascinés " par Baker, ne voulaient s’exprimer qu’en sa présence et recherchaient son approbation tacite : " Nous essayions de lire ses réactions sur son visage ". Il suffisait parfois à l’ancien secrétaire d’Etat " d’un haussement de sourcil pour manifester ses sentiments ".
> Perfidie dans l’élaboration des conclusions : Baker laisse la commission " s’épuiser " sur des sujets secondaires, ainsi que le note Ray Close, un expert de la CIA peu favorable par ailleurs aux néoconservateurs. L’ancien secrétaire d’Etat et ses assistants se réservent la rédaction du rapport final : ce qui leur permet d’écarter les avis ou opinions contraires aux conclusions décidées a priori. Le général de réserve Jack Keane, ancien chef d’état-major de l’Armée, qui faisait partie du pannel militaire de la commission, a ainsi relevé que la commission préconise un retrait accéléré des forces américaines d’Irak dès le premier trimestre 2008, alors que le pannel avait expressément affirmé qu’un tel objectif était techniquement hors de portée, sauf à se résigner à un abandon pur et simple.
Si du moins ces manipulations conduisaient – augusta per angusta – à une politique novatrice, crédible, à un vrai réalisme, à une gestion cynique mais bien comprise des intérêts nationaux américains… Même pas. " Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins nous avions été vendus pour être esclaves et servantes, j’aurais gardé le silence ; mais le persécuteur n’a pas le souci du dommage causé au roi " (Livre d’Esther, VII, 4). A la stratégie George W. Bush, elles n’opposent que la stratégie George H. W. Bush. Comme si rien ne s’était passé, en Orient et ailleurs, depuis la défaite électorale de ce dernier en 1992. Et comme si les divers engagements pris par les Etats-Unis pendant quatorze ans – résister au terrorisme et à l’islamo-fascisme, aider l’Irak à bâtir un régime démocratique, restaurer l’indépendance du Liban, conduire Israël et les Palestiniens à la paix à travers la " feuille de route " – étaient nuls et non avenus. A propos de la Syrie, Baker fait écrire par les rapporteurs de la commission : " Les relations américano-syriennes soient actuellement au plus bas. Mais les deux pays pourraient défendre leurs intérêts respectifs en trouvant des terrains d’entente. Cette approche a fonctionné au début de 1990 " … C'est-à-dire quand les Etats-Unis ont " donné " le Liban à Damas. Et à propos de l’Iran – celui d’Ahmadinejad, en qui les Européens les plus " modérés ", y compris Jacques Chirac, voient désormais un danger absolu, et dont les Saoudiens eux-mêmes s’inquiètent – : " Des efforts diplomatiques devraient être entrepris pour persuader l’Iran de prendre des mesures spécifiques en vue d’améliorer la situation en Irak ". On a bien lu : pour sauver l’Irak, il faudra persuader l’Iran de bien vouloir s’en emparer. De même que pour sauver le Koweit, en juillet 1990, l’ambassadrice Glaspie suggérait à Saddam d’en croquer une aile ou une cuisse.
Sur Israël, le déni du réel et les obsessions s’aggravent, les réitérations et les rabâchages s’accélèrent : visiblement, Baker se dit que ce rapport est sa dernière chance, à soixante-seize ans, d’abattre ou de faire plier l’Etat détesté. Il propose de " négocier la paix " israélo-arabe " comme cela avait été fait lors de la conférence de Madrid " en 1991: faisant l’impasse sur pourparlers et sommets bilatéraux ou multilatéraux qui se sont déroulés depuis, Oslo 1993, Camp David 2000, Charm-el-Cheikh 1999 et 2005. Il souligne que ces négociations doivent être fondés sur le principe " paix contre territoire " : comme si Israël n’avait pas donné presque tous les " territoires " depuis 1993, y compris Gaza, sans obtenir pour autant la paix. Il note que ce processus doit " renforcer les gouvernements arabes modérés de la région, notamment les gouvernements démocratiquement élus du Liban et de l’Autorité palestinienne " : ignorant superbement les hypothèques que le Hezbollah et le Hamas font peser sur la " modération " et la " démocratie " à Beyrouth et à Ramallah. Il rappelle enfin, en guise de conclusion, que l’accord de paix final israélo-arabe doit tenir compte du " droit au retour " en Israël des réfugiés palestiniens de 1948, ou de ceux qui disposent héréditairement de cette qualité (condition équivalant, pour les Israéliens, à un suicide national.
Un instant, on a pu croire que Baker gagnait son ultime pari. Publié quelques jours après les élections de novembre 2006 – qui, effectivement, se sont soldées par une défaite républicaine aux deux Chambres du Congrès – , son rapport a été présenté comme la nouvelle " doctrine " américaine sur l’Irak et le Moyen-Orient. Ce qui a renforcé cette impression, c’est que Robert Gates, vieil ami de Baker et membre de la commission, remplaçait au pied levé Rumsfeld à la tête du Pentagone. Mais la secrétaire d’Etat Condoleezza Rice a remis les choses au point : " Les Etats-Unis sont efficaces quand ils s’appuient à la fois sur leur puissance et leurs principes… Ils ne renonceront pas à leur mission au nom d’une ‘stabilité’(au Moyen-Orient) qui ne pourrait être qu’une stabilité trompeuse ". Rice est trop proche – intellectuellement et humainement – du président pour ne pas être ici son porte-parole. En clair : George W. Bush rejette la démarche " munichoise ". Par conviction. Et parce que cela reste, pour l’instant, le choix de la majorité des Américains, aussi bien démocrates que républicains.
Dans son rapport, Baker énumère plusieurs arguments pour relancer le processus de paix israélo-arabe. Le plus révélateur est celui-ci : " Les Israéliens, dans leur grande majorité, sont fatigués d’être une nation sans cesse en guerre ". Et seraient donc prêts, désormais, à tous les compromis.
C’est bien sûr un contresens absolu. Les Israéliens n’aiment pas la guerre. Ils ne l’ont jamais aimée. Mais ils préfèrent la guerre au suicide. Ou à une nouvelle Shoah.
Mais pourquoi Baker commet-il un tel contresens ? Mon sentiment est qu’il se perd à nouveau dans des jeux de miroirs. De même qu’il a toujours projeté fantasmatiquement son propre lobby pétrolier sur le " lobby juif " , il plaque aujourd’hui sur Israël le refus de combattre qui en est fait le sien, et celui, hélas, d’une moitié de l’Occident.
© Michel Gurfinkiel, 2006