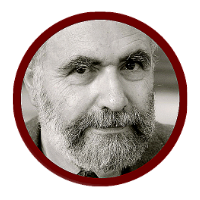Quand Saëb Erekat, le négociateur en chef palestinien, propose de "déjudaïser" Israël, c'est à dire de l'islamiser…
Dis-moi quel ambassadeur tu m’envoies, et je te dirai quelle paix tu me proposes.
En 1995, au lendemain des accords d’Oslo, Yasser Arafat avait nommé Saëb Erekat à la tête de l’équipe chargée de négocier un règlement final avec Israël. Cet homme alors âgé de quarante ans présentait trois qualités : c’était un journaliste – il occupait les fonctions de rédacteur en chef au journal nationaliste palestinien Al-Quds – ; il parlait parfaitement l’anglais, ayant fait des études supérieures en Californie et en Angleterre ; enfin, il manifestait une docilité politique absolue.
Ce profil ne faisait pas nécessairement de lui un bon diplomate, ni a fortiori l’homme d’Etat qui pouvait trouver et imposer des solutions aux nombreux problèmes encore en suspens entre la république juive et le mouvement palestinien. Mais telle n’était pas, en réalité, sa mission. Ce qu’Arafat attendait de lui, c’était de mener, sous prétexte et sous couvert de négociation, une offensive médiatique contre Israël qui, à plus long terme, allait justifier la rupture du processus de paix et une nouvelle offensive terroriste.
Dans ce rôle, Erekat fut en effet efficace pendant cinq ans, et quelquefois brillant. Dispensant tour à tour le chaud et le froid, il préserva le concept de pourparlers bilatéraux jusqu’au sommet de Camp David, pendant l’été 2000, où Arafat rejeta le plan de paix présenté par le premier ministre israélien Ehud Barak, et même au-delà, jusqu’au déclenchement de la « Seconde Intifada » au début de l’automne.
La suite fut moins convaincante. Au printemps 2002, alors qu’Israël réoccupait la Cisjordanie, il consacra beaucoup de temps à promouvoir la thèse d’un « massacre de civils » perpétré par Tsahal à Djénine, au nord du territoire : affirmant le 10 avril que les Israéliens avaient tué 500 civils palestiniens; faisant état, le 12 avril, de 300 victimes, enfouis dans des fosses communes ; le 15, de « crimes de guerre », sans plus de précisions ; revenant, le 17, au chiffre de 500 morts dans une interview à CNN. Erekat s’oubliait, et laissait le propagandiste qu’il était supplanter, en lui, le négociateur qu’il était censé être. Qui plus est, en s’obstinant dans des accusations fluctuantes et sans fondement.
En 2003, Erekat fit semblant de rompre avec le système Arafat. Il démissionna de ses fonctions de négociateur au mois de mai. Mais accepta de le reprendre au mois de septembre de la même année. Quand il succéda au raïs, fin 2004, Abbas s’empressa de confirmer Erekat à son poste. Le mouvement islamiste Hamas fit de même après sa victoire aux législatives palestiniennes, en 2006.
Aujourd’hui, Erekat prépare la conférence d’Annapolis au nom de Mahmoud Abbas et de son nouveau premier ministre, le libéral Salem al-Fayed. Le 13 novembre, il a fait savoir que les Palestiniens ne signeraient aucun accord avec Israël tant que celui-ci se définirait comme un « Etat juif », dans la mesure où « la religion et la politique doivent être séparées ». Pour un représentant de l’Autorité palestinienne, où l’islam est la religion officielle, ce n’est pas trop mal. Pour un négociateur mandaté par une entité membre de la Ligue arabe, dont vingt-et-un membres sur vingt-deux se définissent comme « islamiques », ce n’est pas mal non plus.
Dis-moi quel ambassadeur tu m’envoies, et je te dirai quelle paix tu me proposes. Si Abbas – et al-Fayed – se font représenter par Erekat en 2007, et si celui-ci tient de tels propos, cela signifie quelque chose. Exiger d’Israël qu’il renonce à son identité juive, c’est formuler en fait deux nouvelles revendications, activables dès la signature éventuelle d’un traité de paix :
1. Un Israël qui ne serait plus défini comme « juif » devrait abolir la Loi du Retour, qui permet à tous les Juifs du monde, et même aux non-juifs pouvant établir une ascendance juive partielle, d’y immigrer ou d’y bénéficier d’un asile.
2. Un Israël « déjudaïsé » devrait accéder à toutes les revendications de sa minorité arabe et se transformer en Etat binational judéo-arabe. Les Palestiniens disposeraient ainsi de leur Etat proprement dit, régi par la chariah, et d’un Etat bis, une sorte de second Liban où une laïcité de façade couvrirait une islamisation rampante.
Revendications habiles. La faiblesse idéologique structurelle dont Israël fait preuve face au nationalisme palestinien, depuis la « révolution constitutionnelle » de 1992 – qui a placé la Cour suprême au dessus du parlement – et les accords d'Oslo de 1993, a favorisé l’émergence d’un formidable mouvement sécessionniste chez tous les Arabes israéliens : en Galilée, à Gaza, dans le Néguev, chez les paysans sunnites, mais aussi chez les Bédouins et même les Druzes, jusqu’ici plutôt fidèles à l’Etat. Près de 20 % de la population israélienne aujourd’hui, 25 % demain. Il n’y a guère que les Arabes chrétiens, à faible démographie et peu à peu instruits par le sort de leurs frères du Liban et de Cisjordanie, pour adopter un profil plus bas dans cette affaire.
Tsipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères, a fort justement remarqué le 18 novembre, en recevant son homologue français Bernard Kouchner, que la création d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza devait éteindre toute revendication irrédentiste palestinienne ou arabe, tant à propos des frontières d’Israël que de sa politique intérieure. « On ne peut pas gagner sur les deux tableaux », a-t-elle observé.
Le fait est malheureusement que Mahmoud Abbas et même l’honorable Salem al-Fayed montrent, en conservant Erekat à son poste et en encourageant les scécessionnistes arabes israéliens, que c’est exactement leur intention.
© Michel Gurfinkiel, 2007