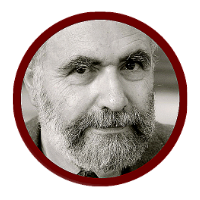Israël avait le droit – moralement, juridiquement, politiquement – d’anéantir le Hamas. Mais était-ce son intérêt, compte tenu de l’évolution de la région ?
Comment en finir avec son adversaire ? C’est l’un des problèmes classiques de la stratégie. La plupart des généraux – et des auteurs qui ont traité de la guerre, qu’ils aient été chefs militaires ou non – ont estimé que le vainqueur devait ménager une issue au vaincu. Cette attitude présente trois avantages.
Le premier, immédiat, est d’abréger la bataille : si le vaincu pense qu’il peut préserver sa vie en battant en retraite, ou en s’enfuyant, il le fera ; ce qui permet au vainqueur d’économiser sa peine, ses forces, la vie de ses combattants et ses ressources matérielles.
Le second, à plus long terme, est qu’un ennemi qui bat en retraite ou s’enfuit est plus facile à achever. Telle est la conduite d’Alexandre de Macédoine à la bataille de Gaugamèles qui, en 331, lui livre l’Empire perse. Il laisse Darius III, son adversaire, se retirer du champ de bataille, se réfugier sur le plateau iranien, et s’y épuiser de chevauchée en chevauchée. Quelques mois plus tard, Darius III sera assassiné par ses derniers compagnons.
Le troisième avantage relève de la stratégie globale. Il est rare qu’une bataille n’oppose que deux adversaires : en général, chacun des belligérants tient compte de tierces puissances, provisoirement non-belligérantes mais susceptibles d’entrer à leur tour dans la bataille. Ces considérations amènent souvent le vainqueur à ménager le vaincu, soit qu’il veuille l’absorber, ou l’enrôler dans une alliance contre d’autres acteurs, soit qu’il craigne, en l’accablant, de susciter la méfiance ou la colère des tiers.
Pour autant, l’autre option – poursuivre le combat jusqu’à l’anéantissement de l’adversaire – semble parfois s’imposer. C’est le cas, en particulier, quand cet adversaire a lui-même démontré, par ses propos, ses actions, ses choix stratégiques, qu’il n’hésitait pas à anéantir ceux qu’il dominait ou vainquait, et qu’il faisait plus encore de cet anéantissement un but en soi.
En annonçant, à la conférence de Casablanca de janvier 1943, qu’ils exigeaient désormais la « reddition sans conditions » de l’Allemagne et du Japon, Roosevelt et Churchill ont peut-être amené ces deux pays à intensifier leur effort de guerre et donc provoqué une prolongation des combats. Ils ont se sont peut-être également privés, dans le cadre d’un renversement des alliances et d’une guerre contre la Russie soviétique, de partenaires utiles. Mais de telles hypothèses étaient en fait vides de sens, face au comportement barbare de l’Allemagne et du Japon : leur mépris de tout droit et de toute notion de bien commun ou d’intérêt international mutuel, l’étendue de leurs agressions et leur propre refus de faire quartier aux vaincus.
Tout au long de la guerre de Cinquante Jours, le conflit qui, du début du mois de juillet à la fin du mois d’août 2014, les a opposé à l’ « Etat-Hamas » de Gaza, les Israéliens ont pesé les deux options : ménager l’adversaire ou le frapper sans relâche jusqu’à son effondrement.
Le premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Moshé Yaalon et le chef d’état major Benny Gantz ont finalement retenu la première option, en ne dépassant jamais un certain niveau d’engagement militaire et en accordant un cessez-le-feu au Hamas.
La plus grande partie de l’opinion publique israélienne et plusieurs membres du cabinet ont au contraire préconisé la seconde option – et manifesté une nette désapprobation face aux décisions de Netanyahu et des chefs militaires. 82 % des Israéliens accordaient leur confiance au premier ministre le 23 juillet, au moment où des unités de Tsahal pénétraient dans la bande de Gaza, dans le but, semblait-il, d’abattre définitivement le Hamas ; 63 % le soutenaient encore le 5 août, quand les opérations terrestres ont été suspendues ; 38 % seulement ont approuvé le cessez-le-feu, signé le 21 août.
Le Hamas répond, de diverses façons, à la définition d’un « adversaire barbare », dont la destruction serait à la fois nécessaire et conforme au droit.
Contrairement aux autres organisations et structures infra-étatiques palestiniennes – le Fatah de Mahmud Abbas et ses deux émanations, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et l’Autorité palestinienne (AP) -, le Hamas n’a jamais évoqué une paix éventuelle avec l’Etat d’Israël ni reconnu en aucune façon l’existence même d’Israël en tant qu’Etat ou nation ; il a au contraire constamment appelé à la destruction d’Israël en tant qu’Etat et nation, et au massacre de sa population.
Maître de Gaza depuis 2007 à la suite d’une guerre civile au sein de l’Autorité palestinienne, il a fait de ce territoire une base opérationnelle contre l’Etat juif et engagé en moins de six ans, de décembre 2008 à juillet 2014, trois guerres successives.
Dans ces guerres, il n’a pratiquement jamais opposé ses propres unités militaires à des unités israéliennes, mais plutôt recouru à des agressions contre la population civile : bombardement aveugle par roquettes et missiles contre des agglomérations civiles, mise en place d’un réseau de tunnels destiné à mener des incursions en territoire civil israélien.
Pendant ces guerres comme pendant les périodes de cessez-le-feu ou de « trêve » qui les ont séparées, le Hamas a planifié, tenté de perpétrer ou effectivement perpétré des opérations terroristes contre des civils israéliens, y compris des enfants et des adolescents, tant à proximité de Gaza que dans le reste d’Israël ou dans les secteurs de la Cisjordanie légalement administrés par Israël. C’est d’ailleurs une opération terroriste de ce type qui servi de cause immédiate au conflit de 2014 : l’enlèvement et l’assassinat par une cellule du Hamas, le 12 juin, de trois adolescents israéliens – âgés de seize ans pour deux d’entre eux et de dix-neuf ans pour le troisième – dans le Gush Etzion, au sud-ouest de Jérusalem.
Chacun de ces faits constitue un crime au regard du droit international et des lois de la guerre, ou une préméditation d’un tel crime. La sanior pars de l’opinion internationale – celle qui se forme dans les nations libres – le sait, mais tend souvent à l’oublier ou à le minimiser, dans la mesure où Israël, plus puissant sur le plan militaire et sur le plan technologique, a été en mesure, jusqu’à ce jour, de contenir ou déjouer la plupart des opérations du Hamas. L’opinion israélienne ne saurait quant à elle entrer dans de telles considérations. Elle est trop bien informée des projets génocidaires du Hamas pour les sous-estimer ; elle sait aussi que dans une relation stratégique dite du « fort au faible », comme c’est le cas entre le Hamas et Israël, le fort ne l’emporte pas nécessairement, et le faible ne perd pas toujours.
Il n’est pas inutile de noter, à cet égard, que le Hamas a voulu dissiper lui-même les dernières illusions que les Israéliens pouvaient entretenir sur ses intentions à leur égard, en diffusant dès le début des affrontements, sur sa radio et par internet, une version en langue hébraïque de l’un de ses hymnes, intitulée Kum, asseh piguim (Lève-toi, commets des attentats). En voici, transposé en français, le texte intégral :
Lève-toi, commets des attentats,
Secoue-les, inflige-leur des coups terribles,
Elimine tous les sionistes,
Ebranle la sécurité d’Israël !
Engage le combat avec les sionistes,
Brûle leurs bases et leurs soldats,
Ebranle la sécurité d’Israël,
Déclenche contre lui le feu des volcans !
C’est un pays de faiblesse et d’illusion,
Face à la guerre, ils ne tiennent pas le coup,
Ils détalent comme des araignées
Quand ils des hommes vaillants leur font face !
Ebranle la sécurité d’Israël,
Jette son cœur au feu comme un ramassis de toiles d’araignées,
Rase Israël jusqu’à ses fondations,
Extermine ce nid de cafards,
Expulse tous les sionistes !
Leur cœur bat la chamade,
Sauve qui peut chez les sionistes !
Ils s’enfuient dans toutes les directions,
Ils ont peur de la mort et ils courent se cacher
Derrière leurs murs et dans leurs abris !
Leur pays n’est qu’une illusion,
Il ne tient plus debout,
Son temps est passé, ce n’est plus qu’un tas d’ordures,
Ils s’enfuient comme des rats dans un champ desséché,
Avance et ouvre le feu sur eux, de tous les côtés !
Secoue les maintenant, ô multitude de missiles,
Change leur monde en une scène d’horreur,
Imprime avec du feu dans leur cerveau
Ce grand prodige : ils sont expulsés,
Et c’est nous qui allons demeurer ici !
Pourtant Netanyahu, Yaalon et Gantz sont passés outre et, une fois établie la capacité d’Israël à déjouer les attaques du Hamas et à infliger, en représailles, des pertes considérables à l’adversaire, ont préféré l’option d’un cessez-le-feu. Pourquoi ? La transformation à la fois rapide et profonde que subit actuellement le Moyen-Orient – l’effondrement partiel du cadre étatique issu de la Première Guerre mondiale – constitue probablement, dans leur décision, un élément-clé. D’une part, Israël doit raisonner plus que jamais en termes de stratégie globale et mouvante, et se garder de séparer un front en activité – en l’occurrence, Gaza et le Hamas – de fronts provisoirement inactifs, mais non moins dangereux. Mais d’autre part, la transformation en cours pourrait, après avoir renforcé dans un premier temps des organisations telles que le Hamas, conduire ensuite à leur implosion. Et plus encore à une redéfinition complète de la question palestinienne.
Souvent qualifié de « système Sykes-Picot », du nom des deux négociateurs, le Britannique Mark Sykes et le Français François Georges-Picot, qui avaient planifié en 1916 le partage des régions non-turcophones de l’Empire ottoman, l’ordre étatique moyen-oriental est miné par une contradiction majeure.
En théorie, il se compose d’Etats-nations, au sens européen du terme : des entités souveraines, sûres de leur identité et de leur légitimité. En fait, quelques uns seulement de ces Etats répondent à une telle définition. le sont effectivement, même s’ils doivent faire face, en leur sein, à des minorités rétives : Israël, la Turquie, l’Iran, l’Egypte.
La plupart ne le sont pas. Linguistiquement ou culturellement, ils se rattachent à des ensembles plus larges, les mondes arabe, kurde, iranien, turc, ou participent de plusieurs de ces mondes à la fois. Politiquement, ils ne disposent ni d’une assise démocratique, ni même d’une assise sociétale – historique ou dynastique – incontestable et incontestée. Si bien que les pouvoirs y procèdent en fait de « fidélités » , de structures en réseaux qui chevauchent ou parasitent les frontières et les administrations officielles : liens du sang (asabiya en arabe), de la famille élargie (bait ou a’ila) au clan (hamula) regroupant plusieurs familles ou à la tribu (ashair) regroupant plusieurs clans ; religion (din), qui se subdivise, tant pour l’islam que pour le christianisme, en un très grand nombre de sectes ; et enfin confrérie militante, religieuse ou militaro-religieuse, politique ou militaro-politique (ahawiya, tarîqa, rbat, ihwan), structure transversale, qui transcende, par son objet même, les autres appartenances.
Certes, cette inversion du politique – la faiblesse ou le caractère quasi-fictif de l’Etat-nation, et la prévalence, en regard, de « fidélités » infra-étatiques, supra-étratiques ou transétatiques – peut se retrouver à divers degrés dans d’autres régions du monde (y compris en Occident, dans des cas marginaux comme la Corse). Mais le phénomène est particulièrement marqué au Moyen-Orient. D’où une instabilité endémique, au sein de chaque Etat, et entre Etats ; une succession de guerres saintes et de révolutions, de putschs et de « printemps » populaires, d’annexions, de fusions, de scissions et de sécessions. En fait, ce qui a préservé un minimum de stabilité régionale pendant quatre-vingt-dix ans, ce sont les interventions de diverses grandes puissances extérieures : Britanniques et Français d’abord, Américains et Soviétiques ensuite, Américains seuls, ou presque seuls, après 1989. Et ce qui accélère aujourd’hui l’instabilité, c’est le retrait unilatéral américain, qui lui-même crée une sorte d’appel d’air favorisant une intervention russe en faveur de l’Iran et de divers acteurs infra-étatiques.
Il faut une certaine naïveté, une certaine inculture historique, pour s’étonner de la désintégration actuelle de la Syrie et de l’Irak, de la Libye et du Yémen, pour déplorer les violences algériennes ou pour croire en un Liban uni et indépendant, pour oublier que les régimes les plus « forts » et les plus durables de la région, les quarante ans de règne de la dynastie Assad, les quarante ans de Kadhafi, les trente-trois ans de Saddam, ont sans cesse trempé dans des guerres civiles et étrangères.
Il faut un mélange de naïveté, d’inculture historique, de refus du réel, de malveillance envers le peuple juif, pour demander à Israël de reconnaître un Etat de Palestine « dans les frontières de 1967 », alors que les territoires palestiniens actuellement autonomes sont plongés dans une situation en tout point analogue à celle de la Syrie, de l’Irak, de la Libye et du Yémen.
Mais d’un mal relatif, l’effondrement d’un « système Sykes-Picot » non-fonctionnel, peut jaillir un bien relatif, ou même absolu : la recomposition de la région à partir d’unités plus petites, plus homogènes, plus légitimes, plus fonctionnelles. La mise en place d’un Etat-nation kurde au nord de l’Irak n’est qu’un exemple à cet égard. Si cette évolution se confirme, la constitution d’un Etat de Palestine serait sans objet, tout comme la reconstitution d’Etats syrien, irakien, libyen ou yéménite.
© Michel Gurfinkiel, 2014