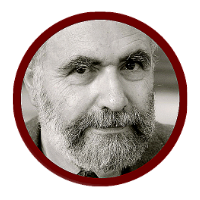Comment un ex-espion désargenté sauva l’honneur d’un ex-Empire …
MICHEL GURFINKIEL
En 1916, quand ils ont atteint respectivement les âges de huit et neuf ans, Ian Fleming et son frère aîné Peter sont envoyés au pensionnat de Durnford, sur la côte du Dorset : une de ces pépinières où les enfants britanniques de bonne famille apprennent à devenir les maîtres du monde. Ce qui implique, en fait, de mémoriser beaucoup de latin et de grec, de dormir à la dure, de s’habituer à des nourritures innommables, d’être persécutés par les élèves plus âgés et de persécuter en retour les plus jeunes. « On sortait de là », écrira plus tard Nicholas Elliott, un condisciple des Fleming qui fera carrière dans les services secrets, « avec le sentiment que désormais rien de pire ne pouvait désormais nous arriver. »
Durnford passe pourtant, au début du XXe siècle, pour le plus « libéral » de ces bagnes pour enfants riches. Le programme comporte, outre Cicéron et Plutarque, des lectures publiques de romans d’aventure : notamment Le Prisonnier de Zenda, célèbre feuilleton de cape, d’épée, de love interest, d’intrigues politiques et géopolitiques, située en Ruritanie, quelque part au fond des Balkans. Et aussi, chaque fois que le temps le permet, des bains d’eau de mer. Comme le rapporte Andrew Lycett, l’auteur de la première biographe d’Ian Fleming, parue en 1975 : « Le directeur, connu sous les initiales de TP, avait fait creuser sur le rivage, à la dynamite, un bassin où maîtres et écoliers venaient barboter ensemble, dans le plus simple appareil… TP, qui ne gardait pour l’occasion qu’un vieux panama vissé sur la tête, se faisait chahuter sans façon par les garçons. » Ces excentricités, tant littéraires que natatoires, font une impression durable sur le petit Ian qui, en fait, règle sur elles le reste de sa vie avant de les sublimer, sur le tard, dans le personnage de « James Bond, agent 007 ».
Ian Lancaster Fleming est né à Londres en 1908, dans le quartier huppé de Mayfair. Son grand-père paternel Robert Fleming, un financier écossais, laisse 3 millions de livres sterling lors de son décès en 1935, soit l’équivalent de 213 millions d’euros en 2020. Son père, Valentine Fleming, l’aîné des cinq enfants de Robert, mène une vie élégante, avant d’être élu député conservateur en 1910 et de se faire tuer en 1917 sur le front de Picardie.
Du côté maternel, un grand père, Sir Philip Rose, a été un collaborateur de Disraeli, et l’autre, Sir Richard Quain, est un chirurgien réputé, consulté par la Cour. La mère, Evelyne Beatrice Ste Croix Rose, dite Eve, ajoute un tempérament artiste à une beauté saisissante : « Elle estimait que l’argent était fait pour être dépensé », écrit Lycett. Mais elle saura gérer le sien, le moment venu, avec un froid discernement. Le couple a quatre enfants : l’aîné, Peter passe pour être de santé fragile. Cela ne l’empêche pas de devenir très vite un voyageur impénitent, notamment au Turkestan et en Chine, puis, très vite, un écrivain à succès. Ian l’admire, non sans le jalouser.
La malédiction des grandes familles britanniques, ce sont les lois successorales. Au droit d’aînesse, souvent en vigueur, s’ajoute la faculté, pour les parents, de disposer arbitrairement de leur fortune par testament, sans de soucier, comme c’est le cas en France, d’une « part réservée ». Robert Fleming, le patriarche, qui n’a jamais
approuvé le mariage de Valentine et d’Eve, accorde à son fils 250 000 livres (une vingtaine de millions d’euros de 2020) et quelques belles propriétés agricoles ; mais il lègue le reste de sa fortune à ses autres enfants. Valentine, à son tour, élabore ce que sa veuve appellera « un méchant testament ». Il lègue sa fortune à un fonds dont elle sera l’unique bénéficiaire : à condition qu’elle ne se remarie jamais.
Ultime déconvenue, qui touche Ian plus particulièrement : Eve favorise, parmi ses enfants, ceux qui ont fondé une famille. Peter lui donne vite satisfaction. Ian n’y parvient pas. Le voici quasiment sans le sou, sans pouvoir renoncer, pour autant, au luxe et aux ambitions dans lesquels il a été élevé. Certes, l’Empire britannique a été bâti par des cadets déshérités, qui n’avaient d’autre choix, pour survivre, que de fonder une colonie outre-mer. Mais en 1930, quand Ian atteint l’âge adulte, il n’y a plus de terre vierge à découvrir ni de contrée à conquérir.
Ian tente donc d’imiter son frère, en voyageant et en écrivant. Principal avantage du pensionnat puis de la public school (en l’occurrence Eton, la plus cotée) : les anciens élèves se soutiennent entre eux. Cela lui ouvre les portes de Reuters, où il apprend l’art des phrases courtes, des choses vues et des détails vrais. En 1933, il séjourne en URSS, portant par provocation « un costume criard en tweed qu’il n’oserait certainement pas mettre en Angleterre ». Moscou le frappe par sa tristesse : « Rien dans les vitrines, à part quelques bustes de Lénine et de Staline ». Il ne décroche pas une interview de Staline (le dictateur a décliné la proposition avec beaucoup de politesse) mais découvre la vodka, qui devient l’un de ses alcools favoris.
Reuters veut l’envoyer à Shanghai. Mais d’autres Old Boys (anciens condisciples) lui offrent un poste d’analyste financier à la City, beaucoup mieux payé, qu’il n’ose pas refuser. Pour tromper l’ennui qui s’attache à cette nouvelle profession, il donjuanise. Dans l’Angleterre des années trente, les classes moyennes restent attachées à la moralité victorienne. Mais la bonne société s’adonne, selon l’expression reçue, à toutes les « charades » possibles. Ian, à qui un nez cassé (suite à un accident de jeunesse) donne un charme de gentilhomme voyou, multiplie les liaisons : tout lui est bon, de l’étudiante ou de la villageoise tyrolienne aux femmes de ses amis. Il parvient même à entretenir plusieurs affaires de front, sans que les intéressées ne s’en offusquent. Beaucoup d’entre elles sont plus âgées que lui, et fort riches. Ian résiste pourtant à la tentation d’un mariage « pour l’argent seulement ».
Le 24 mai 1939, il déjeune au Carlton avec le contre-amiral John Godfrey, sans trop savoir pourquoi, mais en se doutant bien d’une nouvelle intervention discrète des ex-Etoniens. En fait, Godfrey dirige les Services secrets de la Marine (NID) et cherche à encadrer un personnel composé à 90 % de techniciens avec des personnalités plus « imaginatives ». Ian accepte immédiatement. Le salaire n’est pas mirobolant, mais il va avec un titre de commandant de vaisseau et un bel uniforme. Et puis, comment résister au sentiment d’être utile au pays ? Fleming prêtera plus tard à James Bond, au delà de « bien des vices », deux vertus : le courage physique et le patriotisme.
Sur le plan personnel, la Seconde Guerre mondiale est pour Ian une époque faste. Il joue enfin un rôle important, qui lui vaut notamment d’être informé de secrets d’Etat, tels que l’existence des machines Enigma. On sollicite son avis, et certaines de ses suggestions sont retenues, comme la création d’une unité spéciale chargée exclusivement, au milieu des combats, de mettre la main sur les documents confidentiels de l’ennemi. Il voyage : au cours d’une mission à la Jamaïque, il se prend de passion pour ce pays. Il assiste aussi au basculement du monde : l’Empire britannique s’efface au profit de l’Empire américain, l’univers colonial s’effiloche. A la paix, va-t-il redevenir le cadet sans fortune qu’il a toujours été ?
Pas exactement. L’âge venant, il se marie enfin. Il renoue avec le journalisme : mais cette fois, c’est en tant que grand reporter au Sunday Times. Et il obtient, chaque hiver, un congé pour « écrire des livres », qu’il passe à Goldeneye (« L’œil d’or »), une bicoque sans grand confort – ni vitres – qu’il s’est fait construire, avec un prêt de sa mère, sur la côte nord de la Jamaïque. Le plus simple serait de donner une forme littéraire à des souvenirs de guerre : mais il est tenu, compte tenu de ses états de service, à une discrétion presque totale.
Soudain, en 1952, c’est le déclic : sur le point d’être arrêtés pour espionnage, un physicien nucléaire britannique, Donald Maclean, et un officier des services secrets, Guy Burgess, viennent de se réfugier en URSS. Cette affaire rocambolesque donne à Fleming l’idée d’écrire un roman d’espionnage contemporain, Casino Royale.
Il crée, à cette occasion le personnage de James Bond, agent de Sa Majesté « autorisé à tuer », Ecossais par son père et Français par sa mère. Il lui a fallu huit semaines pour rédiger un texte de 62 000 mots. Le livre paraît en 1953 et rencontre à la fois un succès d’estime et un début de succès commercial. L’éditeur commande de nouveaux ouvrages, avec le même héros.
A quoi tient le charme des James Bond ? Avant tout au fameux « style Reuters », sec et nerveux. Ensuite aux choses vues, aux petits détails qui sonnent juste, glanés au NID et au hasard des voyages. A la pincée d’érotisme : là encore, Fleming sait de quoi il parle. Aux gadgets électroniques, aux scénarios retors, aux suspens vertigineux. Et finalement au « non-dit du discours », l’arrière plan géopolitique. A mesure que paraissent les romans – une quinzaine en douze ans -, l’Empire britannique s’effiloche au profit de l’Empire américain. Mais Bond, l’agent infaillible, sauve l’honneur.
En 1962, le cinéma s’empare de 007, avec James Bond contre Dr No. Le rôle a été confié à un jeune acteur écossais au teint foncé, aux cheveux noirs, venu de la classe ouvrière : Sean Conery. Fleming n’y croit pas. Il se trompe. Conery a la forme athlétique indispensable. Et les manières distinguées, il les apprend vite. Bond, ce sera lui pour l’éternité, même si le rôle sera ensuite repris par une succession d’acteurs blonds. Les films, triomphes planétaires, transforment les livres proprement dits en best sellers, tirés à des millions d’exemplaires.
Voici Fleming millionnaire. Mais il est bien tard. Les cigarettes, l’alcoolisme et les excès érotiques ont miné sa santé. Il meurt d’une crise cardiaque à 56 ans, le 11 août 1964, quinze jours après l’enterrement de sa mère. Comme l’observe Christian Destremeau, son dernier biographe en date, le monde d’aujourd’hui, avec ses dictateurs électroniques et ses terroristes sadiques, ressemble étrangement à celui qu’il avait entrevu.
______
Andrew Lycett, Ian Fleming. Orion, 1995.
Christian Destremeau, Ian Fleming, Les vies secrètes du créateur de James Bond.
Perrin, 2020.
© Michel Gurfinkiel & Valeurs Actuelles, 2020
Historien et spécialiste des questions géopolitiques,
Michel Gurfinkiel est Ginsberg-Ingerman Fellow au Middle East Forum.