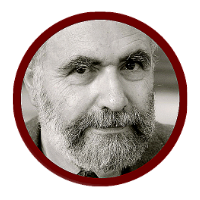Pourquoi Alain Juppé a brièvement relancé le fantasme d’une « médiation » française au Proche-Orient.
Le Serpent de Mer est revenu : la France a voulu exercer sa « médiation » entre Israéliens et Palestiniens, en organisant une « conférence de la paix » à Paris. « Jusque là, personne ne m’a dit non », déclarait Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères le 7 juin, après avoir présenté son projet à Jérusalem, à Ramallah et à Washington. Ce qui signifiait aussi que personne ne lui avait dit oui.
Il avait d’abord été question, au Quai d’Orsay, de réunir cette conférence dès le mois de juin. Ensuite, on a évoqué « l’été », ou « fin juillet », sans plus de précision. Israël était d’emblée réticent : l’Etat hébreu a toujours eu de l’aversion pour les rencontres de ce type, qui lui rappellent la fatidique rencontre de Munich, en 1938, où les Grandes Puissances démembrèrent une autre démocratie, la Tchécoslovaquie, au nom de la paix.
Les Etats-Unis, qui gèrent le processus de paix israélo-palestinien depuis 1993, et qui ont envisagé eux-mêmes de convoquer et de présider une éventuelle conférence arabo-israélienne, ont eu le sentiment que la France cherchait à les « doubler » : rencontrant Juppé le 6 juin, la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton a estimé qu’une réunion de ce genre nécessitait « un long travail préparatoire ». Les Palestiniens auraient été a priori favorables au projet Juppé, qui ne pouvait que renforcer leur image internationale. Mais d’un autre côté, ils ne voulaient pas s’aliéner un peu plus, en y accédant, la bienveillance de l’administration Obama.
Ces rebuffades étaient prévisibles. Juppé aurait pu en tenir compte ; il a préféré les braver. Parce que, depuis de Gaulle, les « médiations » diplomatiques de la France relèvent en fait de la politique intérieure.
Quand il fonde le régime nationaliste et étatiste connu sous le nom de Ve République, en 1958, Gaulle veut rendre la « grandeur » à un pays meurtri par la défaite de 1940, la décolonisation et un déclin démographique ou économique apparemment inexorable. A cette fin, il revendique sur la scène internationale, chaque fois que l’occasion se présente, un rôle d’arbitre ou de défenseur des faibles et des opprimés : une « gesticulation » qui ne repose alors que sur un seul atout, la qualité de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, mais qui lui d’affirmer à bon prix son « indépendance » face aux « Empires » en général et à l’ « Empire américain » en particulier. Cela plaît à la plus grande partie de l’opinion publique, de la vieille droite maurassienne à la nouvelle gauche marxisto-structuraliste. Cela présente en outre l’avantage de servir les intérêts de l’Union soviétique, et donc d’assurer, à travers une alliance tacite avec un parti communiste qui contrôle alors le quart de l’électorat, la pérennisation du régime.
Les successeurs de de Gaulle, tant de droite, de Georges Pompidou à Nicolas Sarkozy, que de gauche, de Mitterrand à Jospin, ne renoncent pas à ces atouts. Le contexte géopolitique change : fin de la guerre froide, transformation du Marché commun en Union européenne, émergence d’un monde polycentrique. Le contexte politique aussi : disparition du parti communiste, montée du Front national, immigration islamique massive. Mais les attitudes de « grandeur », d’« indépendance nationale » et de « médiation » restent d’autant plus populaires que la France redevient véritablement – résultat des stratégies gaulliennes ou effet indirect de la construction européenne ou de la mondialisation – une grande puissance économique, technologique, et même militaire.
Dès son élection à la présidence de la République, en 2007, Nicolas Sarkozy cherche à consolider sa légitimité par ce moyen. Toutes les causes sont bonnes, pourvu qu’il en soit le chevalier. En Libye, il obtient la libération de personnels médicaux bulgares et palestinien condamnés à mort en Libye sur une fausse accusation d’empoisonnement : moyennant une visite officielle de Mouammar Kadhafi à Paris. Il lance, en s’appuyant sur son très gaulliste conseiller Henri Guaino, l’Union Pour la Méditerranée (UPM), « structure de dialogue » entre l’Europe, l’Afrique et l’Orient. Pendant l’été 2008, il s’interpose avec quelque succès – au nom de l’Europe, dont il assure la présidence pour un semestre – dans le conflit russo-géorgien. Ce qui ne l’empêchera pas, peu de temps après, d’amorcer une sorte d’ « entente cordiale » avec la Russie de Poutine.
Mêmes « gesticulations » sur le Proche-Orient. Avant son élection, Sarkozy avait fait étalage des sentiments pro-israéliens. Une fois installé à l’Elysée, il se rallie à la doctrine « cubiste » – aussi juridiquement inexacte que stratégiquement inconsistante – du Quai d’Orsay : Israël doit se retirer des territoires « occupés » en 1967 (comme s’ils n’avaient pas été saisis dans une guerre non seulement défensive mais de survie), revenir aux « frontières internationales » de 1949 (comme si la France les avait reconnues pour telles de 1949 à 1967, ou même après 1967), et accepter la création d’un Etat palestinien souverain disposant d’une « continuité territoriale » (ce qui impliquerait, apparemment, qu’Israël soit privé de cette même continuité). Pendant la bataille qui oppose Israël au Hamas à Gaza, en 2008-2009, il condamne le « manque de proportionnalité » des opérations de Tsahal. Ce qui revient à les blâmer elles-mêmes.
La conférence Juppé pour la paix au Proche-Orient répond cependant à des préoccupations beaucoup plus immédiates. En 2010, Sarkozy, trois ans après son élection, est au plus bas dans les sondages. Pour survivre ou ressusciter, il renonce à toute « ouverture à gauche » et appelle la droite à « faire bloc ». Le gaulliste François Fillon reste premier ministre, la gaulliste Michèle Alliot-Marie devient ministre des Affaires étrangères. Mais les révolutions arabes, pendant l’hiver 2011, bousculent ces efforts.
Les des fêtes de fin et de début d’année, Alliot-Marie passait des vacances en Tunisie, Fillon en Egypte, et Guaino en Libye. Or le dictateur tunisien Zine el Abidine Ben Ali, est chassé du pouvoir au mois de janvier, et le dictateur égyptien Hosni Moubarak à la mi-février. Quant à Kadhafi, il fait face, dans la foulée, à la révolte de la moitié au moins des Libyens. Sarkozy règle l’affaire à la hache. Alliot-Marie est révoquée, Fillon tancé, Guaino placardisé. Il faut maintenant un communicant pour réparer le mal : un spin doctor, comme disent les Américains. Ce sera Juppé. L’excellent, l’aimable, le talentueux Juppé. L’ancien premier ministre, de pure race gaulliste, qui sut se faire condamner à la place de Chirac dans les affaires – vénielles – de la Ville de Paris. L’éternel maire de Bordeaux, la ville la plus courtoise – et la plus cynique – de France.
Le 27 février, Juppé retrouve le Quai, où il officia, fort bien d’ailleurs, au début des années 1990. Il mène les choses rondement. Intervention militaire en Libye, en liaison avec les Anglais, les Américains – via l’Otan – et même la Ligue arabe. Rencontres avec les « rebelles » d’Egypte, à commencer par les Frères musulmans : « Plusieurs d’entre eux m’ont fait part de leur vision d’un islam libéral et respectueux de la démocratie ». Rencontres avec la « société civile palestinienne ». Rappel de la doctrine française : « Retour aux frontières internationales » antérieures au 5 juin 1967. Juppé proteste de son souci pour Guilad Shalit, soldat franco-israélien enlevé en territoire israélien par le Hamas gazaoui, mais établit une équivalence entre son cas et celui du Franco-Palestinien Salah Hamouri, détenu en Israël à la suite d’un procès pour tentative de meurtre sur la personne d’un rabbin. Quand on l’interroge sur les « flottilles de la paix » que des organisations françaises veulent envoyer à Gaza, ou du moins financer, il regrette de « ne pas avoir les moyens de s’y opposer » – même si ses services travaillent discrètement à l’ajournement ou à l’annulation décès opérations.
Le projet d’une conférence internationale sur le conflit israélo-palestinien couronne ce crescendo. Mais en fait, il est superfétatoire. L’habile Juppé a déjà gagné : en juin, plus personne n’évoque les imprudences méditerranéennes d’ Alliot-Marie, de Fillon et de Guaino. Si bien qu’à peine la conférence annoncée, le Quai d’Orsay peut la mettre sous le boisseau.
Mais les Israéliens – et leurs amis français – doivent savoir que le projet ressortira un jour ou l’autre. C’est dans l’ADN de la Ve République. C’est le Serpent de Mer.
(c) Michel Gurfinkiel, 2011.