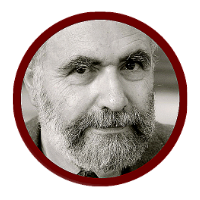Les processus de paix israélo-arabes se suivent et ne se ressemblent pas. Sauf sur un point : aucun n'a conduit, à ce jour, à une paix réelle.
Le propre d’un processus de paix israélo-arabe, c’est qu’il n’aboutit pas.
Le premier processus de ce type a eu lieu en 1949, au lendemain de la guerre d’indépendance israélienne. N’étant pas parvenus à détruire l’Etat juif dans son berceau, les pays arabes voisins sont prêts à coexister avec lui. Dans un premier temps, ils signent à Rhodes des accords d’armistice, ce qui constitue une reconnaissance de facto. Dans un second temps, ils engagent des pourparlers en vue d’une reconnaissance de jure. Parallèlement, l’ensemble du monde arabe – y compris des Etats qui n’avaient pas participé aux opérations militaires de 1948 – souscrit à l’idée d’un échange de populations entre Juifs et Arabes en Palestine et dans le reste du Proche et du Moyen-Orient : en « compensant » le récent déplacement, en Palestine même ou à proximité, d’un demi million d’Arabes palestiniens par le transfert forcé de leurs propres populations juives – près d’un million d’âmes au total – en Israël, moyennant rançon. Le Yémen est le premier pays à conclure un tel accord, dès 1949. L’Irak suit en 1951. D’autres pays arabes font de même, de façon plus discrète, tout au long des années 1950 et 1960 (1).
Ce premier processus de paix s’est interrompu en raison de ce que l’on appelle généralement la « radicalisation » du monde arabe. En termes clairs, des réseaux fascistes, qui avaient admiré et soutenu l’Allemagne hitlérienne et l’Italie mussolinienne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, prennent partout le pouvoir : en Egypte, avec les « Officiers libres » de Nasser, en 1952 ; en Syrie, avec le Mouvement nationaliste arabe et ses alliés, en 1958 ; en Algérie, avec le FLN, en 1962 ; en Syrie à nouveau, avec le parti Baath, dès 1963, et en Irak, avec le même parti, la même année ; en Libye, avec Mouammar el-Kadhafi, en 1969. Pour diverses raisons, à commencer par des alliances stratégiques avec l’Empire soviétique ou avec la Chine maoïste, ces réseaux adoptent en général à cette époque une rhétorique marxisante ou marxiste. Mais le fascisme – et plus encore le national-socialisme – constitue toujours leur référence ultime.
Un second processus de paix commence en 1970, trois ans après la guerre des Six Jours. Le roi Fayçal d’Arabie Saoudite – qui n’appartient pas à la mouvance fasciste arabe mais partage nombre de ses obsessions, à commencer par l’antisémitisme – observe que la paix sera impossible au Moyen-Orient tant qu’Israël ne sera pas revenu aux lignes antérieures à 1967 : le secrétaire d’Etat William Rogers amplifie ces propos et les interprète comme une promesse de paix en cas d’évacuation.
Jérusalem oppose une fin de non-recevoir : la proposition saoudienne est trop vague, et le royaume, de toute façon, n’est pas la principale puissance arabe. Le Congrès américain rejette également le plan Fayçal-Rogers. Car un retrait israélien ne bénéficierait qu’à des alliés de l’URSS : l’Egypte, la Syrie, les premières confréries militantes palestiniennes. Les Saoudiens ne cessent de revenir sur leur projet. Ils en sont actuellement à leur 5e version. Au fil des années, un autre thème a pris de l’importance dans leur démarche : le « droit au retour » des réfugiés palestiniens de 1948 et de leur descendance, qui n’a pourtant aucun fondement, ni juridique (aucun autre groupe de réfugiés n’a bénéficié d’une telle héréditarisation), ni morale (l’exode des juifs des pays islamiques est ignoré). Cela revient en fait à demander la transformation d’un Israël réduit à ses frontières de 1967 en Etat binational judéo-arabe.
Dans leur ultime version, que les Saoudiens ont fait endosser par l’Organisation de la conférence islamique, le problème des réfugiés serait résolu par « une approche commune ». Une concession qui n’en est pas une, puisque qu’elle est formulée à partir d’une exigence inique.
Troisième processus : celui que le premier ministre israélien Menahem Begin et le président égyptien Anouar el-Sadate initient en 1977. En se rendant à Jérusalem, après plusieurs mois de négociations secrètes avec les Israéliens, et en y affirmant : « Plus jamais de guerre ! », Sadate change la géopolitique régionale. Certes, Sadate a été un fasciste pro-allemand dans sa jeunesse, rallié à ce titre à Nasser. Et l’on ne peut écarter l’hypothèse selon laquelle l’un de ses objectifs, dans ce voyage, est de priver Israël de l’un de ses principaux atouts stratégiques : la liberté d’action que confère le « refus » arabe . Mais Zvi Mazel, le diplomate israélien qui connaît le mieux l’Egypte, ayant été en place dans ce pays pendant sept ans, trois ans en tant que ministre plénipotentiaire et quatre ans en tant qu’ambassadeur, note : « Sous Sadate, le gouvernement égyptien éduquait le peuple égyptien pour la paix ». Ce qui n’a pas été le cas de son successeur, Hosni Moubarak.
Cinquième processus : avec les Arabes palestiniens. En 1947, les Juifs palestiniens leur reconnaissent le droit à leur Etat, conformément aux décisions de l’Onu. Mais celui-ci ne prend pas forme : à la faveur de la guerre de 1948, la Transjordanie s’empare de la Cisjordanie et l’Egypte de Gaza. Quarante-cinq ans plus tard, en 1993, Israël signe à Oslo un accord-cadre avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat, qui assure la mise en place de Territoires palestiniens autonomes et doit, à terme, conduire à la création d’un Etat indépendant. Mais Arafat utilise ces Territoires pour relancer le conflit en 2000. Mahmoud Abbas, qui lui a succédé fin 2004, refuse de reconnaître Israël en tant qu’ « Etat juif ». Mohamed Dahlan, l’un des principaux adjoints d’Abbas, ne reconnaît pas du tout Israël. Quant au Hamas, maître de la moitié des Territoires palestiniens depuis 2007, il ne reconnaît ni Israël, ni Abbas.
Sixième processus de paix : avec la Jordanie. Les Juifs palestiniens puis les Israéliens ont toujours entretenu des relations discrètes avec la dynastie hachémite qui gouverne ce pays. Ce qui n’a pas empêché plusieurs guerres. En 1994, Jérusalem et Amman signent un traité de paix, et s’engagent dans une coopération économique étroite, avec la bénédiction des Etats-Unis. Mais une fois encore, la Jordanie préfère jouer sur deux tableaux : en avril 2009, le roi Abdallah II vient de menacer Israël d’une guerre globale avec le monde arabe dans dix-huit mois, si celui-ci n’accélère pas ses négociations avec Abbas. Ce qui vide le traité de 1994 de l’essentiel de sa signification.
NOTE
(1) On consultera avec intérêt l’ouvrage qui vient d’être publié chez Denoël sous la direction de Shmuel Trigano : « La fin du judaïsme en terre d’islam ».)
© Michel Gurfinkiel, 2009