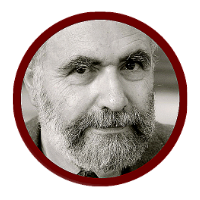Les vrais vainqueurs du 6 novembre, ce sont les analystes et consultants politiques, qui ont prévu l’élection in extremis d’Obama. Au terme d’une division sans précédent de la société américaine.
La campagne présidentielle vient d’en apporter la preuve : les analystes politiques américains connaissent de mieux en mieux leur métier.
Les instituts de sondage n’ont commis aucune erreur majeure en 2012. C’est particulièrement net quand on relit le RCP Average, la moyenne des principaux sondages que publie chaque jour le magazine en ligne Real Clear Politics. Cet indice révélait, l’été dernier, que Barack Obama était susceptible d’être réélu, en dépit d’un bilan quadriennal médiocre. Il a ensuite perçu, à l’automne, la percée de Mitt Romney. Avant de noter que le président sortant remontait, in extremis, dans les derniers jours d’octobre. Le 6 novembre au matin, il accordait à Obama un avantage décisif, ce que les résultats finaux ont confirmé douze heures plus tard.
Au total, Obama a obtenu 61,7 millions de voix sur 122,2 millions (50,6 %), et Romney 58,5 millions (47,8 %). Mais il faut tenir également compte de 1,1 million (près de 1 %) pour Gary Johnson, un ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique passé à la nouvelle droite « libertarienne ». Et 400 000 voix (0,34 %) pour une candiate d’extrême-gauche, Jill Stein. Globalement, la gauche américaine l’a donc emporté par 62,1 millions de voix face aux 59,5 millions de la droite (51 % contre près de 49 %).
Les analystes et consultants ont eu raison sur un second point : le « rythme » de la campagne. Ils ont toujours affirmé qu’une élection reposait sur quelques « moments forts » psychologiques. Notamment le mois d’octobre, dernière ligne droite avant un scrutin fixé depuis 1845 au premier mardi de novembre : une « surprise » intervenant pendant cette période – qu’il s’agisse d’un événement fortuit ou d’une mise en scène délibérée de la part d’un candidat – peut décider de l’élection.
En 2012, il n’y a pas eu une « surprise d’octobre » , mais deux, successives et de caractère opposé. D’abord la victoire de Romney sur Obama lors du premier débat télévisé entre les deux candidats, le 3 octobre : en une soirée, le candidat républicain est devenu le favori. Puis l’ouragan Sandy, à la fin du mois. Pour des raisons complexes, ce désastre a renforcé l’image du président sortant. Et lui a permis de retrouver un léger avantage sur Romney. En anglais, on qualifie une catastrophe naturelle d’ « acte de Dieu » : « act of God ». Forte et juste formule…
Troisième succès des analystes : le caractère déterminant des identités collectives et plus particulièrement des « facteurs raciaux et ethniques » (« race and ethnicity »). Les consultants ont souligné dès le début de la campagne que celle-ci serait, pour l’essentiel, un duel entre les Américains classiques, Blancs de culture européenne attachés aux valeurs judéo-chrétiennes, et une coalition de Nouveaux Américains issus des minorités raciales traditionnelles (Amérindiens, Noirs) ou de l’immigration (Hispaniques, Asiatiques, immigrants des pays d’islam).
Le pronostic, là encore, a été validé. Romney a obtenu 59 % des suffrages chez les Américains classiques, Obama 39 % seulement. Mais chez les Nouveaux Américains, Obama l’emporte de très loin : 93 % chez les Noirs, 73 % chez les Asiatiques, 71 % chez les Hispaniques, 58 % dans les autres communautés. « Obama l’emporte dans un pays divisé au plus haut point », titrait le quotidien USA Today.
Les Nouveaux Américains ne constituant pour l’instant qu’un tiers de l’électorat américain au mieux, la victoire finale d’Obama a tenu au soutien des 41 % d’Américains classiques qui ont fait défection au « candidat naturel » de leur milieu, Romney. Faisant ainsi preuve d’une plus grande liberté de pensée – ou d’un réalisme moins marqué – que les Nouveaux Américains.
Quatrième point : de nombreux consultants avaient noté que les identités religieuses pouvaient corriger les identités ethniques. En l’occurrence, c’est d’ailleurs moins l’appartenance à une famille religieuse qui compterait, que le type d’engagement religieux et le niveau de pratique.
Les communautés judéo-chrétiennes les plus exigeantes en matière religieuse et rituelle (catholiques traditionalistes, protestants évangéliques, juifs orthodoxes, mormons) ont en effet voté pour Romney, les moins exigeantes pour Obama. Chez les juifs américains, qui semblent avoir voté à 69 % pour Obama, on frôle en fait le schisme : les orthodoxes – minoritaires mais démographiquement ascendants – s’étant massivement portés pour les républicains, et les non-orthodoxes – majoritaires mais démographiquement déclinants – pour les démocrates.
Cinquième et dernière prédiction des analystes : le « basculement » vers Obama des jeunes électeurs (de 18 à 29 ans) et des femmes. Les premiers (19 % de l’électorat) ont voté à 60 % pour le président sortant ; les secondes (53 % de l’électorat) à 55 %. L’écrivain conservateur D. G. Myers observe, sur le blog de Commentary, que « les républicains, s’ils veulent survivre, ne peuvent pas être seulement le parti des vieux hommes blancs ».
Mais ces chiffres, comme ceux qui concernent la communauté juive, doivent être affinés. Chez les jeunes, la démographie générationnelle rejoint la démographie ethnique et raciale : les milieux non-blancs, nés dans le pays ou immigrés, ont relativement plus d’enfants et d’adolescents que les milieux blancs, ce qui assure quasi automatique une surreprésentation des obamistes dans leur tranche charge. En ce qui concerne les femmes, elles ont tendance depuis plusieurs décennies à voter un peu plus que les hommes pour les démocrates, parti de la protection sociale. Mais il faut tenir compte également, comme chez les jeunes, du poids croissant des femmes non-blanches.
Ces chiffres, ces tendances, ces évolutions, Barack Obama les connaît mieux que quiconque. Quelles conclusions en tirera-t-il pour l’avenir ? Pendant son premier mandat, le quarante-quatrième président des Etats-Unis a oscillé entre réalisme et utopisme, entre la volonté de s’inscrire dans une histoire américaine bicentenaire et la tentation de « tiers-mondiser » l’Amérique. Pendant son second mandat, il peut être tenté de clarifier sa politique, dans un sens ou l’autre. S’il opte pour l’Amérique de toujours, il pourrait devenir, toutes choses égales d’ailleurs, l’un des Pères fondateurs de la nation, après Washington, Lincoln, Roosevelt et Reagan. Mais s’il opte au contraire pour une Nouvelle Amérique ?
Le discours qu’il a prononcé le 7 novembre au matin pour prendre acte de sa victoire n’est pas rassurant à cet égard. D’emblée, il a présenté l’Amérique comme « un pays colonisé qui a conquis sa liberté voici plus de deux cents ans », ce qui est quelque peu réducteur. Il a fait de « la remise en état du système d’immigration » – de son ouverture – une priorité. Il a défini les Etats-Unis comme un mélange « de Noirs, de Blancs, d’Hispaniques, d’Asiatiques, d’Amérindiens, de jeunes, de vieux, de personnes valides ou invalides, de gays et d’hétéros ».
L’ordre dans lequel ces groupes sont présentés n’est pas indifférent : les Noirs avant les Blancs, les jeunes avant les vieux, et les gays avant les hétéros.
© Michel Gurfinkiel & Valeurs Actuelles, 2012