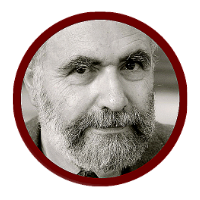L’ordonnance de Villers-Cotterêts fait du français la langue de l’Etat et de la justice. Elle n’a pas fondé une « Francophonie » sans rivages.
Villers-Cotterêts, département de l’Aisne, dix mille habitants, patrie d’Alexandre Dumas, municipalité Front national depuis 2014, sera la capitale de la Francophonie. Ainsi en a décidé le président de la République, Emmanuel Macron, le 20 mars dernier. A cette fin, une « ville dans la ville » devrait être mise en place d’ici 2022. Elle gravitera autour de l’ancien château royal : la restauration de ce bâtiment édifié de 1532 à 1539, pillé à la Révolution, dégradé en dépôt de mendicité sous Napoléon Ier, puis en maison de retraite, aujourd’hui à l’abandon, sera supervisée – ou médiatisée – par le journaliste Stéphane Bern. Mais la Cité de la Francophonie comprendra également des structures hôtelières et artistiques, des centres d’exposition, des établissements pédagogiques, des parcs.
Pourquoi Villers-Cotterêts ? Parce que François Ier y signa en 1539 l’ordonnance qui fit du français la langue officielle du royaume : c’est ce que chacun sait – ou croit savoir. Le symbole, en effet, ne manque pas de force. Mais la réalité historique est infiniment plus complexe. L’ordonnance, quand on la lit attentivement, n’aborde la question linguistique que de manière incidente : elle n’y consacre que deux articles sur cent quatre-vingt-douze. Et surtout, le français était déjà langue officielle dans les domaines les plus divers, parfois depuis fort longtemps…
Le texte de 1539 a été rédigé par le chancelier de France, Guillaume Poyet : d’où sa première appellation, dans les manuels, de « Guilelmine ». Patricien angevin, Poyet a été l’avocat de Louise de Savoie, la mère de François Ier, puis avocat général et président à mortier du parlement de Paris, avant d’accéder en 1538 à la plus haute dignité juridique de l’Etat. Il doit sans doute son ascension à la faveur des Grands qu’il a servis ; mais il la mérite par l’étendue de ses connaissances, la sûreté de sa doctrine, et un sain réalisme.
Promulguée un an à peine après sa nomination, l’ordonnance de Villers-Cotterêts en témoigne : intitulée Ordonnan du Roy sur le faid de justice, c’est une sorte de réforme générale des procédures, menée dans un but – très moderne – de clarification et de simplification. Les premiers articles délimitent les compétences respectives des juridictions ecclésiastiques et séculières. D’autres répriment le « fol appel », les recours abusifs qui paralysent la justice. L’article 109 prescrit ainsi : « Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interpréter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l'entérinement de leursdites requestes ».
Les articles 139 à 144 imposent aux juges la plus grande « diligence » en matière criminelle, sous peine d’amendes ou de lourdes sanctions. Les articles 148 à 162 encadrent les procédures criminelles : ils établissement en particulier que l’accusé ne peut être interrogé avant d’avoir « communication » pleine et entière des faits qu’on lui reproche. Et l’article 168 reconnaît formellement les cas de légitime défense.
Le même souci d’une justice efficace et accessible conduit Poyet à imposer partout des actes écrits, seul moyen de vérifier les assertions des uns et des autres. Ainsi les articles 173 à 177 obligent-ils les notaires et autres à conserver leurs minutes ou archives. Et les articles 50 à 55 créent-ils l’état-civil : des registres officiels où seront enregistrés « en forme de preuve », les naissances, baptêmes et décès avec leur « temps et heure » . La France royale sera le premier Etat à recourir systématiquement à une telle pratique.
Par extension, Poyet en vient aux articles 110 et 111, les seuls qui, près de cinq cents ans après leur promulgation, sont toujours en vigueur. L’article 110 prescrit le recours à une langue claire et intelligible : « Et afin qu'il n'y ait cas de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ni lieu à demander interprétation. » Quant à l’article 111, il précise que dans la mesure où l’emploi du latin a souvent nui à cette « intelligence », on ne s’exprimera qu’en « langage maternel français et non autrement ».
Qu’est ce donc que ce « langage maternel français » ? Certains juristes déduiront du rejet explicite du latin, langue des clercs, que ce terme recouvre toutes les langues parlées du royaume : le français d’oïl, ses variantes, l’occitan et le provençal, le bas-breton… De fait, quand Louis XIV annexera l’Alsace, il y respectera l’emploi officiel de l’allemand. Et la Constituante, en 1790, envisagera brièvement de faire traduire les nouvelles lois dans tous les parlers populaires.
Mais l’opinion qui prévaut, c’est que le « langage maternel » ne peut être que le « français du Roi », tel qu’il est parlé à Paris, dans les pays de Loire… et à la Cour. Cette interprétation s’étaie sur de solides précédents en matière administrative ou juridique. Dès le XIIIe siècle, les notaires royaux et les agents de la Couronne écrivent en français. Dès le XIVe, on utilise le français dans les interrogatoires et procès verbaux : les minutes du procès de Jeanne d’Arc, au début du XVe siècle, ont été rédigés dans cette langue. Même dans le Midi, la langue d’oïl supplante peu à peu, pour ces usages, la langue d’oc.
Ce qui joue également en faveur du « français du Roi », ce sont des réflexes patriotiques. Le français est l’une des premières langues « vulgaires » européennes qui, entre le XIIe et le XVe siècle, se sont dotées de littératures susceptibles de rivaliser avec l’héritage latin : des romans du cycle courtois (Chrétien de Troyes) à la poésie (Guillaume de Lorris, Rutebeuf, Charles d’Orléans, François Villon), et de celle-ci aux chroniques (Froissart, Commynes). Il a même acquis un statut de langue internationale : à la fin du XIIIe siècle, le Pisan Rustichello rédige en français le Devisement du Monde, récit d’un long séjour en Asie centrale et en Chine, sous la dictée du Vénitien Marco Polo ; un demi-siècle plus tard, l’Anglais Jean de Mandeville choisit la même langue pour écrire son Livre des Merveilles du Monde, qui décrit un périple analogue.
L’imprimerie, à partir des années 1450, renforce la vitalité du français mais aussi la concurrence avec les autres parlers nationaux : l’italien de Dante, Pétrarque et Boccace, l’allemand qui a « annexé » la Bible avec la traduction de Luther, l’anglais qui fait de même avec William Tyndale. Les humanistes français, de Rabelais à la Pléiade, entendent dès lors « défendre » et « illustrer » leur langue – selon le mot de Joachim du Bellay. Et l’ordonnance de Villers-Cotterêts constitue, à leurs yeux, un appui décisif. Avec la création de l’Académie française, en 1634, l’alliance du pouvoir royal et du nationalisme linguistique est consommée : « Qui est au Roi parle français. Qui parle français est au Roi ». Le décret du 2 thermidor an II reprend cette doctrine au profit de la République et de l’Etat centralisé moderne.
Tous les textes régissant aujourd’hui l’emploi de la langue française se réfèrent aux articles 110 et 111 de Villers-Cotterêts. Notamment les textes récents, qui cherchent à maintenir ou à rétablir la « souveraineté » du français – et donc une intelligibilité mutuelle entre les citoyens – face aux empiètements de l’« anglais global », aux revendications régionalistes ou aux incursions, par le biais de l’immigration, de langues non-européennes. L’ordonnance de François Ier est l’une des sources de l’article 2 de la Constitution actuelle, révisé en 1992, qui précise que « le français est la langue de la République ».
On ne peut que se féliciter aujourd’hui de l’intérêt que le président Macron manifeste pour la « mémoire » de Villers-Cotterêts. Mais y inclure la Francophonie relève peut-être d’un contre-sens. Par définition, les francophones étrangers ne sont pas « au Roi », ni à la République, à commencer par les plus proches d’entre eux : Wallons de Belgique, Romands de Suisse, Valdotains d’Italie, Franco-Canadiens. Ils cherchent souvent à préserver leur propre identité culturelle et linguistique, qui n’est pas exactement celle de l’Hexagone ou de l’Outre-Mer. A plus forte raison les francophones plus éloignés, pour lesquels le français n’est que la plus prestigieuse des langues étrangères (c’est le cas de la Roumanie, par exemple), une langue post-coloniale au statut contesté, ou une option pour d’éventuelles migrations.
© Michel Gurfinkiel & Valeurs Actuelles, 2018
Membre du Comité éditorial de Valeurs Actuelles, Michel Gurfinkiel est le fondateur et président de l’Institut Jean-Jacques Rousseau (Paris), et Shillman/Ginsburg Fellow au Middle East Forum (Philadelphie).