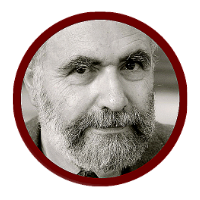Pourquoi ils sont nécessaires. Pourquoi ils peuvent être toxiques.
DE L’INTUITION CREATRICE A LA NECROSE SCOLASTIQUE
Point de société sans paradigme. Cela est vrai des sociétés en général comme des infrasociétés ou « sous-sociétés » plus restreintes, vouées à des activités plus spécialisées : milieux professionnels, entreprises, églises, associations amicales, clubs ludiques, partis politiques, etc.
Qu’est-ce qu’un paradigme ? Un cadre et des repères communs – conceptuels ou symboliques -, une « règle du jeu » admise par tous. Mais surtout une intuition ou un ensemble d’intuitions qui stimulent la société considérée ou l’activité dont elle est le vecteur. Un paradigme n’est pas un système d’exploitation, un logiciel, un code, un langage, une constitution – mais le désir, la vista, qui conduit à l’élaboration de ce système, de ce logiciel, de ce code, de ce langage, de cette constitution. Le paradigme d’Apple, par exemple, ce ne sont pas MacOS et iOS, mais l’exigence de simplicité, de beauté, de rapidité, qui a contraint des équipes d’ingénieurs et de techniciens à imaginer l’un puis l’autre. Le paradigme d’un Etat ou d’une nation, ce ne sont pas les lois, les règlements, le programme politique du parti au pouvoir, mais un narratif, un mythe, qui crée, parmi les citoyens, confiance et élan.
L’intuition, le désir, la vista sont fugaces. Les paradigmes ne sont jamais donnés une fois pour toutes. Ils « vivent », se forment, évoluent, se dégradent – et sont finalement remplacés par des paradigmes nouveaux. Ils peuvent être particulièrement opérants, stimulants, à certains moments de leur cycle de vie, ou devenir au contraire inopérants, contre-opérants, toxiques. Les élites ou les Establishments qui gouvernent ou dirigent les sociétés ou infrasociétés devraient se rendre compte sans cesse du degré d’efficience ou au contraire d’inefficience d’un paradigme. Ils devraient, le cas échéant, réajuster un paradigme obsolescent, rejeter un paradigme toxique, rechercher un nouveau paradigme. Mais ils ont maintes raisons de ne pas le faire. Leur statut d’élites ou d’Establishments est lié à un paradigme dont ils sont devenus les experts et les virtuoses. Ils craignent, si un nouveau paradigme émerge, d’être déclassés. Tant et si bien que les modèles déclinants, morts et toxiques jouent, dans l’histoire générale des paradigmes, un rôle au moins aussi important que les modèles émergents, vivifiants et productifs.
Le conservatisme des élites – et par voie de conséquence le ralentissement ou le délitement des sociétés ou activités dont ils ont la charge – est flagrant dans des domaines où l’on s’attendrait le moins à le trouver : la science et la philosophie.
Dans La Structure des Révolutions scientifiques (1962), l’épistémologue américain Thomas Kuhn observe que les sciences progressent de manière chaotique, erratique, à travers des phases d’intensité diverses, des percées et des stagnations. Les progrès scientifiques rapides surviennent quand un paradigme « vertueux », particulièrement heuristique, permet de « résoudre des énigmes » en grappes, de relier de plus en plus de faits entre eux, et d’en découvrir sans cesse de nouveaux : une situation qu’il qualifie de « science normale ». Mais ensuite, des « anomalies » apparaissent et se multiplient : des faits aberrants, réfractaires, qui ne peuvent être expliqués, ni reliés à ce qui est déjà connu. Ces « anomalies » n’infirment pas le paradigme en tant que tel : ils en montrent les limites et permettent donc, quand on les prend en compte, d’imaginer un nouveau paradigme, plus heuristique encore. Le Britannique Karl Popper, avec lequel Kuhn a débattu, estime d’ailleurs qu’une démarche n’est réellement scientifique que dans la mesure où elle est constamment sujette à de telles « crises » ou révisions, qu’il qualifie, dans son propre vocabulaire, de « falsifications ».
Mais Kuhn note que les personnels scientifiques, habitués à travailler au sein d’un paradigme donné, ayant pu constater à de multiples reprises de l’efficacité de ce paradigme, préfèrent ignorer les « anomalies » le plus longtemps possible, les récuser ou les interpréter comme de simples « erreurs » : « Chez certains spécialistes », observe-t-il, « la nouvelle théorie implique un changement dans les règles qui gouvernaient jusque là la pratique de la science normale. D’où un retentissement inévitable sur une partie du travail scientifique qu’ils ont déjà réalisé avec succès ». En termes plus explicites : ils sont d’autant plus attachés à l’ancien paradigme qu’ils doivent leur statut professionnel à la dextérité avec laquelle ils le manient, notamment dans leurs publications et autres compte rendus de recherche.
Ce déni aggrave la crise, la prolonge, et freine indument la créativité ou la productivité scientifiques. Jusqu’à ce que ce blocage provoque une révolte généralisée de la communauté scientifique contre le paradigme dépassé, et facilite donc paradoxalement le passage à un paradigme complètement nouveau, qu’auront élaboré des esprits curieux ou rebelles. Il n’y a pas transition d’un paradigme à l’autre, selon Kuhn, mais révolution, saut dans le vide. D’où le titre même de son ouvrage.
Un autre épistémologue américain, Randall Collins, a soutenu dans The Sociology of Philosophies (1998), que le travail réflexif dans son ensemble (théorie, science, philosophie) s’effectue à travers des stratégies individuelles (« grands penseurs ») ou de groupe (« écoles »), des filiations et des révoltes, des alliances ou des conflits.
Les personnes qui s’engagent dans ce travail – les « intellectuels » – doivent sans cesse calculer leur « trajectoire » en fonction des « hiérarchies » existantes et des moyens de les subvertir, des positions dominantes et des espaces vierges disponibles. « Ce qui fait de quelqu’un un intellectuel, c’est le désir de participer au flux général de la ‘pensée’, et plus précisément d’entrer dans le centre incandescent des débats, là où circulent, au moment présent, les idées les plus ‘sacrées’ ou valorisées, afin, si possible, d’y raccrocher ses propres idées… »
La créativité « implique de nouvelles idées » : on ne peut attirer l’attention de la communauté intellectuelle centrale « en répétant ce qui déjà été énoncé ». Les idées ne peuvent pas être trop nouvelles non plus, sous peine d’être inaudibles : « Un intellectuel qui aurait exposé la théorie einsteinienne de la relativité générale à l’époque hellénistique n’aurait pas fait carrière, parce que son sujet aurait été trop éloigné de toutes les notions alors accessibles ». Si bien que « les intellectuels qui réussissent le mieux s’inscrivent à la charnière de deux générations » : tout en se mettant sous la protection, ou le « label », d’un maître reconnu, ils en sont en fait suffisamment indépendants pour miser sur des idées inédites.
Mais statistiquement, la plupart des intellectuels ne jouissent pas d’une telle latitude. « A de nombreuses époques, la communauté intellectuelle se met en mode scolastique : elle se consacre au culte de textes éminents venus du passé, qui contiendraient toute la sagesse humaine. On ne peut atteindre l’éminence intellectuelle, dans ce mode, qu’en devenant le gardien le plus fidèle et le plus minutieux des grands classiques ». Tournant sur eux-mêmes, les paradigmes perdent progressivement de leur efficace. De soutien ou de stimulant, ils se transforment en obstacle ou en gangrène. Le moment vient où ils sont rejetés, presque instantanément, au profit de nouveaux paradigmes.
PARADIGMES POLITIQUES
Les schémas épistémologiques de Kuhn et de Collins s’appliquent aux domaines politique et géopolitiques.
De même que la science ou la philosophie oscillent entre des périodes de grande créativité et des périodes de stagnation, de même l’histoire des Etats, des nations, des empires, des oecumènes, oscille-t-elle entre des âges lumineux, où quelques principes permettent de cerner et de résoudre de nombreux problèmes, et des âges obscurs, où ces principes n’opèrent plus.
De même qu’un paradigme scientifique ou philosophique devenu inopérant reste longtemps en place après son épuisement, et de ce fait nécrose doublement la recherche et la réflexion, soit en ralentissant les efforts en cours, soit en retardant l’apparition d’un paradigme plus opérant, de même un paradigme politique tend-il à perdurer alors que son efficacité diminue ou disparaît, et de ce fait à brouiller la perception de problèmes nouveaux, ou freiner le passage à un paradigme plus efficace.
Dans les deux sphères, science et philosophie d’une part, politique et géopolitique d’autre part, la dégradation d’un paradigme résulte moins de la multiplication de problèmes inédits que de l’inertie des personnels qui y sont confrontés.
Dans les deux domaines, enfin, le passage de principes morts à de nouveaux principes vivants est subit, global, sans appel.
On peut illustrer les deux processus par une même suite de courbes de Gauss : des ascensions brusques et rapides, suivies de lentes relaxations, puis d’affaiblissements inexorables et cumulatifs, et enfin, à nouveau, d’ascensions brusques et rapides. Nous parlerons, dans la sphère politique et géopolitique, d’un passage répété par quatre étapes : Eurêka, Doxa, Mandala, Métanoïa.
L’Eurêka politique (de l’expression grecque signifiant J’ai trouvé !) est le surgissement de solutions lisibles, simples, cohérentes, globales et opérantes, face à des problématiques urgentes. Ces solutions peuvent s’appuyer sur des traditions, sur un travail doctrinal préalable, ou tirer au contraire leur force et leur pertinence de leur caractère absolument inédit, d’un rejet de toute tradition et de l’ajournement ou de l’annulation des débats qui avaient cours jusque là. Ce qui compte, c’est qu’elles soient des solutions, qu’elles « marchent ».
Exemples d’Eurêkas : la mise en place d’une tétrarchie au sein de l’Empire romain à la fin du IIIe siècle, afin de faire face à un collapsus démographique et sociétal ; la mise en place d’une monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne après la Glorieuse Révolution de 1688, afin de concilier la stabilité sociale et les libertés personnelles ; la Révolution américaine, dans ses deux moments successifs : la Déclaration d’Indépendance de 1776 et le débat constitutionnel de 1786-1787 ; la géométrisation de la société sous la Révolution française, de 1789 à 1814, réponse aux crises de l’Ancien Régime ; la mise en place d’une monarchie constitutionnelle, autoritaire et sociale en Allemagne sous Bismarck, en 1871 ; la révolution Meiji dans le Japon du XIXe siècle, c’est à dire l’adoption intégrale du modèle scientifique, technologique, social et politique européen afin de préserver l’indépendance nationale ; la révolution communiste de 1917, qui prétend surmonter les « contradictions du capitalisme » et redonner un Etat à la Russie ; la révolution kémaliste de 1920, qui substitue un Etat-nation turc à l’Empire ottoman ; la révolution national-socialiste, qui permet de sortir de la crise économique et de restaurer la puissance allemande ; le New Deal rooseveltien, qui permet de sortir de la crise de 1929 ; la réorganisation du monde libre ou de l’Europe à la fin des années 1940, destinée à éviter la répétition des erreurs et des drames de la « guerre de Trente ans » 1914-1945 et à résister à l’expansion soviétique ; la réorganisation de la France sous les IVe et Ve Républiques, dont l’objet est d’inverser la chute des années 1870-1940… Cette liste est loin d’être exhaustive.
Mais il y a une interaction paradoxale entre l’Eurêka et la problématique qui l’a suscitée. L’efficace, l’acuité, du premier est liée à l’urgence de la seconde. Dès lors qu’une solution a été trouvée, l’urgence décroît – et le paradigme se relâche, s’affaisse, se dégrade.
Une première relaxation transforme l’Eurêka en Doxa (« opinion établie » ou « croyance établie » en grec). Une fois démontrée l’efficacité du nouveau paradigme, ses inventeurs sont cooptés par le pouvoir politique et chargés de le transmettre aux futures générations dirigeantes, à travers des institutions spécialisées : écoles, partis, confréries. Cela implique de rationaliser ou d’ idéologiser ce qui relevait de la pure intuition, et de présenter de façon discursive, méthodique, systématique, catéchétique, ce qui tenait de l’évidence et du pragmatisme : ou encore, pour reprendre l’image que nous avons utilisée au début de cette note, de substituer un système d’exploitation à une intuition créatrice. En outre, le paradigme qui n’était initialement qu’un instrument du pouvoir politique se transforme en attribut de ce même pouvoir, incitant des inventeurs concurrents à proposer des contre-paradigmes, qu’il s’agisse de versions modifiées, hérétiques, du paradigme dominant, ou de solutions radicalement différentes.
Pendant une ou deux générations, ou une génération et demie – les inventeurs du paradigme, devenus transmetteurs, et leurs successeurs immédiats -, les effets négatifs de cette relaxation semblent négligeables. Les inventeurs-transmetteurs, la plupart des élèves et la plus grande partie de l’opinion publique conservent en effet, par expérience personnelle ou tradition familiale, un sentiment assez clair des circonstances dans lesquelles le paradigme s’est imposé, et des conditions dans lesquelles il doit être appliqué. Les contre-paradigmes peuvent rencontrer quelque succès dans telle ou telle autre infrasociété, mais suscitent encore du scepticisme ou de la méfiance dans le corps principal de l’opinion – le mainstream.
Une deuxième relaxation se produit quand les générations fondatrices disparaissent : le passage de la Doxa en Mandala (d’un terme sanskrit signifiant « vecteur de méditation », et par extension processus mental réduit à un pur formalisme).
Les personnels qui gèrent désormais le paradigme, héritiers légitimes ou non des prescripteurs, ne savent plus résister à des demandes politiques ou sociétales qui en altèrent l’économie et la logique : la seule chose qui leur importe, c’est de maintenir la rhétorique, la scolastique, la mieux-disance, qui assurent leur statut et leur prestige. Le Mandala en vient à inclure et justifier ce que l’Eurêka rejetait : ainsi la réforme romaine du IIIe siècle, voulue par des empereurs hostiles au christianisme, semble avoir facilité, à partir de Constantin, une christianisation générale ; ainsi la géométrisation française de 1789, conçue comme une émancipation, a-t-elle d’abord conduit à la Terreur puis renforcé un Etat autoritaire, bureaucratique et militarisé …
Le Mandala peut durer longtemps. Jusqu’à ce que la société soit confrontée à une crise majeure, létale, qu’elle ne sait plus ni surmonter, ni dissimuler. Cela devrait susciter immédiatement un nouvel Eurêka. C’est parfois le cas : Charles de Gaulle propose d’emblée en juin 1940, face à l’effondrement du paradigme de la IIIe République, l’Eurêka d’une France « éternelle », maintenue, qui continue le combat. Mais le plus souvent, la société entre dans un long interrègne, une longue quête : la Métanoïa (« changement d’esprit » en grec, et par extension collapsus mental ou psychique), ultime relaxation où l’on tente à la fois de « réformer », réagencer, le paradigme mort et de recourir à des contre-paradigmes, des contre-Doxas, ou même à des contre-Mandalas – utopies révolutionnaires ou réactionnaires, doctrines antinomiques, délires conspirationnistes ou déconstructionnistes.
L’AMERIQUE ET L’EUROPE
En 1945, le monde est américain. Huit décennies plus tard, il l’est toujours. Le PNB américain représente à lui seul 25 % du produit brut mondial (20 000 milliards de dollars sur 80 000 dollars) : ce qui est énorme compte tenu d’une croissance planétaire exponentielle (+1600 % depuis 1950), de la reconstruction des belligérants de l’hémisphère oriental dans l’immédiat après-guerre, de la percée japonaise des années 1970 et 1980, des émergences coréenne, chinoise et indienne des années 1990-2010. Au cœur de ce succès, l’informatique, dont les Etats-Unis ont été constamment le leader, d’IBM aux Gafam. Le budget militaire américain de 2017 (610 milliards de dollars) équivaut à lui seul au total des budgets des huit grandes puissances suivantes (623 milliards). Washington a perdu le monopole de l’arme nucléaire classique dès 1949, et a même été momentanément dépassé par Moscou dans le domaine thermonucléaire en 1953 : mais de nouvelles technologies, notamment la miniaturisation, lui ont permis de reprendre l’avantage dans les années 1960. De même, l’avance prise entre 1957 et 1961 par Moscou dans le domaine spatial, avec la mise en orbite du premier satellite artificiel autour de la Terre puis le premier vol orbital humain, est-elle rattrapée dès 1969 : ce sont des astronautes américains, et non des cosmonautes russe, qui foulent le sol lunaire. Enfin, depuis les années 1980, les Etats-Unis ont été le principal initiateur et le principal bénéficiaire de la « Révolution dans les affaires militaires » (RAM) : le développement des armes intelligences et de la gestion informatisée des champs de batailles.
Plus encore, les Etats-Unis ont refaçonné le monde à leur image. D’abord en organisant à la fin des années 1940 et au début des années 1950, des deux côtés de l’Atlantique, ce que l’on a appelé le « Monde libre » ou « l’Occident » : un périmètre de coopération économique, politique et militaire, structuré par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le GATT (qui deviendra l’OMC), le Plan Marshall et son corollaire, l’OECE (qui deviendra l’OCDE), et enfin l’Otan. Puis en favorisant, au sein de ce périmètre, une coopération régionale entre les pays ouest-européens qui, d’étape en étape, a conduit à la création d’une Union confédérale regroupant presque tous les Etats du Vieux Continent. Puis, dans les années 1950, 1960 et 1970, en ouvrant ce monde à l’Extrême-Orient non-communiste. Et enfin, à partir des années 1980 et 1990, à travers un marché mondial, « globalisé », ouvert aux pays post-communistes, Chine et Russie, ou aux pays émergents, comme l’Inde. Ce sont ces cadres successifs qui ont permis, pour l’essentiel, la croissance des années 1945-2010, qu’Angus Deaton, prix Nobel d’Economie en 2015, a décrite comme « la grande évasion de l’humanité hors de la pénurie et de la mort précoce ».
Les paradigmes qui ont régi ou inspiré les Etats-Unis tout au long de cette période revêtent donc une importance particulière. Par eux-mêmes, où par l’influence qu’ils ont exercé sur d’autres paradigmes dans d’autres pays. On relève deux Eurêkas au moins : les projets à la fois ambitieux et mesurés des administrations Franklin Roosevelt et Harry Truman entre 1942 et 1947 et la Révolution conservatrice reaganienne des années 1980 ; deux grandes Doxas classiques, faisant suite aux Eurêkas, sous les administrations Dwight Eisenhower et John Kennedy d’abord, de 1952 à 1963, puis sous les administrations George H. Bush et Bill Clinton, de 1989 à 2001 ; une dégradation rapide, de la Doxa au Mandala et de celle-ci à la Métanoïa, sous Lyndon Johnson, entre 1964 et 1968 ; un Eurêka imparfait, sous Nixon, de 1969 à 1972, suivi, après le scandale du Watergate et le désastre vietnamien, par une rechute dans la Métanoïa sous Gerald Ford et Jimmy Carter, de 1974 à 1981 ; un Mandala puis une brève et violente Métanoïa sous George W. Bush, de 2001 à 2009 ; un faux Eurêka, suivi d’un long Mandala dans les premières années de Barack Obama, de 2009 à 2015, suivi d’une nouvelle Métanoïa.
Ce qu’il faut d’abord retenir, c’est que deux Eurêkas et demi (Roosevelt-Truman, Nixon, Reagan) ont suffi à préserver la puissance américaine sur une durée presque séculaire, d’autant plus qu’ils ont été suivis de deux longues Doxas. Dans les trois cas, ils ont été l’œuvre de non-conformistes : les Six Sages des années 1940, Dean Acheson, Charles Bohlen, Averell Harriman, George Kennan, Robert Lovett, John McCloy, patriciens capables de prendre le contre-pied des habitudes nationales ; Nixon, « bouseux » méprisé à la fois par la grande bourgeoisie républicaine et par les intellectuels libéraux, et Kissinger, universitaire d’origine européenne, accusé de cynisme ; les intellectuels reaganiens, efin, improbable pléiade de catholiques traditionalistes et de juifs ex-marxistes qui se sont croisés à la National Review de William Buckley, au Public Interest d’Irving Kristol ou au Commentary de Norman Podhoretz.
Mais les fléchissements ou effondrements des années 1964-1968 et 1974-1980 ne sont pas moins dignes d’intérêt, en sens inverse. Comme David Halberstam l’a démontré en 1972 dans The Best and The Brightest (titre français : On les disait les plus intelligents), les ministres et conseillers de Kennedy et de Johnson, issus des meilleurs écoles et virtuoses de la Doxa post-rooseveltienne, n’ont pas su voir les les « anomalies » qui se multiplient soudain, à l’intérieur comme à l’étranger : tensions raciales, violence politique – allant jusqu’à l’assassinat du président en 1963 -, inflation, émergence d’une contre-culture à la fois hédoniste et irrationaliste, enlisement au Vietnam. Quant à la Métanoïa de la fin des années 1980, un autre brillant universitaire, Zbigniew Brzezinski, mentor électoral puis conseiller présidentiel de Carter, n’a fait que l’aggraver en croyant trouver un Eurêka dans des concepts tels que la « société technétronique » ou la « géopolitique trilatérale ».
La campagne électorale américaine de 2016 a vu à la fois l’échec d’une Doxa conservatrice chez les républicains, défendue par Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, face à l’Eurêka populiste de Donald Trump, et l’effritement d’un Mandala libéral chez les démocrates, défendu par Hillary Clinton, face à la Métanoïa gauchiste de Bill Sanders. Les élections ont donné un avantage léger mais décisif à Trump, devenu le quarante-cinquième président des Etats-Unis. Mais pour qu’un Eurêka donne toute sa force, il faut de la durée. Il a fallu plus de trois ans aux Six Sages pour mettre en place la Pax Americana ; Reagan n’a été crédible qu’au bout de deux ans ; Nixon, en dépit d’initiatives spectaculaires en politique intérieure ou étrangère, n’a jamais réussi à se faire accepter par les élites et les médias.
L’Europe a connu ses propres successions d’Eurêkas, les uns nationaux (prescrits par Konrad Adenauer en Allemagne, Charles de Gaulle en France, le roi Juan Carlos en Espagne, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne), les autres continentaux (le projet européen de Jean Monnet, Robert Schumann et Alcide de Gasperi). Au fil des décennies, ils se sont tous dégradés en Doxas, Mandalas et Métanoïas. Sont-ils arrivés au terme de leur cycle dans les années 2010 ? C’est peut-être le sens profond des crises ou révolutions populistes en cours, en Grande-Bretagne, en Italie, dans l’Europe centrale et orientale. Et même en France avec les phénomènes Le Pen et Mélenchon, et le météore Macron.
© Michel Gurfinkiel, 2017
Cette note a été présentée le 23 novembre 2017 à l’Ecole Militaire, lors de la Journée de l’Intelligence économique et stratégique de l’IHEDN.
Membre du Comité éditorial de Valeurs Actuelles, Michel Gurfinkiel est le fondateur et président de l’Institut Jean-Jacques Rousseau et Shillman/Ginsburg Fellow au Middle East Forum.