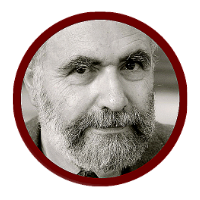Renoncer à la famille et à la natalité, c’est se condamner à l’immigration. Une « loi d’airain » que Valeurs Actuelles a perçu dès les années 1970.
Le 9 novembre 1970, dans la soirée, le général de Gaulle meurt chez lui, à Colombey-les-Deux-Eglises, en faisant une patience. Il avait refusé à l’avance les funérailles nationales : mais quand on l’enterre dans le cimetière du village, trois jours plus tard, quarante mille personnes se pressent sur place et dans les champs environnants, dans un rayon de plusieurs kilomètres. Dans toutes les communes de France, on sonne le glas. A Paris, un requiem est dit à Notre-Dame, en présence de son successeur à la présidence de la République, Georges Pompidou, et de dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement étrangers. Cinq cent mille personnes vont défiler en silence de Notre-Dame à l’Arc de Triomphe : l’itinéraire que le général avait suivi, au milieu d’une autre foule, lors de la libération de la capitale, le 25 août 1944…
Les jours suivants, tous les journaux et magazines consacrent leur une ou leur couverture à de Gaulle. Sauf Valeurs Actuelles. Ce n’est pas de l’irrespect, mais une volonté d’aller, même en cet instant, plus loin que la seule émotion. De fait, un article de Raymond Bourgine, sur deux pages, cerne l’événement. Titre : La France continue. Avec le recul, c’est peut-être l’hommage le plus profond que l’on rend alors au fondateur de la Ve République. Une idée-force : la démographie.
De Gaulle avait remarqué le 6 mai 1966 à André Passeron, le journaliste du Monde accrédité auprès de l’Elysée : « Nous avons été jadis un pays énorme. Nous sommes faits pour être un pays énorme. C’est ce qu’il faut que nous cherchions à réaliser. »
Bourgine commente : « La France de Louis XIV, c’était en Europe, numériquement, un pays énorme : de 22 à 24 millions d’habitants. L’Angleterre n’en avait pas plus de six ou sept. Toutes les Allemagnes, pas plus de quinze. » Et plus d’un siècle plus tard, « contre Napoléon et ses 30 millions de Français, il fallait, pour faire le poids, coaliser toute l’Europe. » Ensuite, « depuis 1840 à peu près, pour une raison mystérieuse, le peuple français ne fait plus d’enfants ». Dans le reste de l’Europe, les autres nations prolifèrent. « En 1940, la France en était à 40 millions d’habitants. En regard : 75 millions d’Allemands. » Ce qui explique, plus que tout, la défaite.
La natalité reprend en France en 1945 : là encore, pour une « raison mystérieuse ». Certes, le monde euro-américain, URSS comprise, connaît alors un « baby boom ». Mais en France, il est plus fort qu’ailleurs : « 18 pour mille », note Bourgine. Chaque année, 800 000 petits Français s’ajoutent à la communauté nationale. L’Allemagne ne fait pas mieux, c’est à dire qu’elle fait moins bien. Si ces taux se maintenaient, les populations française et allemande pourraient être à égalité en l’an 2000. Et la France redeviendrait vers 2020 le premier pays d’Europe par le nombre.
De Gaulle n’aborde jamais la question démographique en tant que telle en public ; mais il y revient sans cesse, en privé, avec ses confidents. L’un d’entre eux, Michel Debré, osera prôner ouvertement une « France de cent millions d’habitants ». Mais le baby boom ne dure pas. Dans tous les pays européens ou de souche européenne, il s’essouffle dans les années 1960 et s’arrête dans les années 1970. La France ne fait pas exception.
Le « mystère » de la renaissance française d’après-guerre se heurte en effet à des changements sociologiques sans précédent. Positifs en soi, mais lourds d’effets paradoxaux.
La vie s’allonge : l’espérance de vie moyenne des Français, qui était de 45 ans en 1900, et de 60 ans en 1950, va atteindre près de 80 ans en 2000, un chiffre qui englobe la réduction drastique de la mortalité néonatale et infantile. Parallèlement, les Françaises obtiennent le droit de vote en 1945, et leur part dans la population active double entre les années 1950 et les années 1990, rejoignant ainsi quasiment celle des hommes. Qui ne se réjouirait de ces deux évolutions ? Mais par voie de conséquence, le mariage et la famille traditionnelle, assurances contre la précarité, semblent moins nécessaires qu’auparavant.
La scolarité s’allonge : obligatoire jusqu’à 14 ans en 1950, elle passe à 16 ans en 1959 et à 18 ans – de facto – dans les années 1980. Le baccalauréat, privilège de 5 % des jeunes Français en 1950, est attribué à 11 % d’entre eux en 1960, 20 % à partir de 1968, et finalement 80 % après 1980. Corollaire : la population universitaire, des deux sexes, passe de 97 000 en 1945 à 510 000 en 1968 et enfin près de 1,5 million après 1995. Là encore, on ne peut que se réjouir. Mais des études prolongées, une entrée plus tardive dans la vie active, cela entraine également le report de l’âge moyen des unions stables et de la procréation.
Au même moment, la pilule fait son apparition : un procédé contraceptif mis au point dans les années 1950 par un scientifique américain, Gregory Pincus. Elle est légalisée, pays après pays, dans les années 1960. En France, c’est un parlement à majorité gaulliste qui vote en 1967 la loi Neuwith, autorisant son utilisation – en dépit des réserves de de Gaulle et de Debré.
La pilule est facile d’emploi, efficace à près de 100 %, et donne l’avantage aux femmes dans le couple : pour la première fois dans l’histoire, elles peuvent décider seules leurs maternités et de la taille de leur famille. Ce pourrait être l’instrument du bonheur. Ce le sera pour les femmes qui savent l’utiliser comme un simple instrument. Mais il y aussi les femmes – et les hommes – qui voient en elles un moyen de se délivrer de toute responsabilité en matière sexuelle, et qui vont faire de cette irresponsabilité une fin en soi. Avec ce résultat étrange : au lieu de prévenir le recours à des formes plus traumatiques de contraception, comme l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la pilule va les banaliser et les légitimer.
Là encore, c’est un parlement de droite, dominé par les giscardiens et les gaullistes, qui aligne le droit sur le fait en dépénalisant l’IVG par la loi Veil : votée le le 15 janvier 1975, sept ans à peine après la loi Neuwirth.
Le 26 mai 1975, Michel Debré lance un cri d’alarme dans Valeurs Actuelles : « Les peuples qui n’ont pas de respect pour leur perpétuité et pour les sentiments qui les font vivre sont condamnés à de grandes épreuves. » Il prédit, au-delà d’une « société sans enfants », une « société qui vieillit », dont les capacités de travail et d’entreprise s’amenuisent, et où « les générosités sociales », y compris les retraites destinées à un troisième âge puis à un quatrième âge de plus en plus étendus, ne sont plus possibles… Mises en garde analogues de l’historien Pierre Chaunu qui, dans son essai De l’Histoire à la Prospective, paru au même moment, rappelle que « la croissance démographique conditionne toutes les autres », et qui qualifie en 1976 l’irresponsabilité sexuelle et l’antinatalisme, dans un livre d’entretiens avec le journaliste Georges Suffert, de « peste blanche ».
Debré et Chaunu ne seront pas entendus. Mais les faits leur donneront raison : au-delà, parfois, de leurs pires craintes.
En quarante ans, les législations organisant la « libération sexuelle » conduisent à l’effondrement du mariage (auquel les deux tiers des Français, au début du XXIe siècle, préfèrent la simple cohabitation ou le Pacs), à la dislocation ou à la « recomposition » de la famille, et bientôt à l’occultation des rôles sexuels innés ou traditionnels. Ce dernier point ne va d’ailleurs sans de nombreuses contradictions, puisqu’on impose simultanément, par des textes votés entre 1999 et 2011 par des parlements de droite comme de gauche, une parité hommes-femmes, c’est à dire des quotas fondés sur des différenciations physiques, puis, à la travers la loi de 2013 sur le « mariage pour tous », votée par un parlement de gauche, la négation des mêmes différenciations.
Comme Debré et Chaunu l’avait pressenti, cette « révolution culturelle » va de pair avec l’effondrement de la fécondité : de 3 enfants par femme en 1950 à 1,6 en 1990. Et donc un vieillissement global de la population : les plus de 65 ans, qui formaient 11,4 % de la population en 1950, en constituent 18,4 % en 2015. Elle coïncide également, toujours conformément à leurs prédictions, avec un ralentissement économique, d’abord sectoriel – la « France à deux vitesses » – puis généralisé ; avec l’apparition des « trous » de la Sécurité sociale et des régimes de retraite, l’endettement de l’Etat, la hausse de la fiscalité.
Pourtant, sur un point capital, Debré et Chaunu semblent s’être trompés : la population française ne stagne pas, mais passe au contraire de 53 millions en 1975 à près de 67 millions en 2016 ; et la fécondité remonte à 2 enfants par femme vers 2010, le seuil qui assure le renouvellement des générations. Une société permissive peut-elle donc, finalement, se perpétuer ? Non. Alfred Sauvy, que Valeurs Actuelles interrogeait souvent, a résumé un jour la question d’une formule lapidaire : « Ce sont nos enfants, ou ceux des autres. » Ce que la natalité ne peut fournir, c’est l’immigration qui l’a apporté.
Les immigrations traditionnelles, d’origine européenne et judéo-chrétienne, ont maintenu la France à flot à la fin du XIXe siècle et au début du XXe : elles se francisaient sans difficulté à travers l’école publique. Mais à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, les autres pays occidentaux ne font pas plus d’enfants que la France, et les nouveaux immigrés viennent d’ailleurs : d’Extrême-Orient, d’Asie du Sud, d’Amérique latine, et surtout du Moyen-Orient et d’Afrique. Certains d’entre eux, en particulier les Asiatiques, se francisent aussi bien que leurs prédécesseurs. D’autres se comportent moins en immigrants, respectueux de la civilisation qui les accueille, qu’en migrants, décidés d’imposer à la France et à l’Europe une civilisation tenue pour plus virile, donc supérieure.
En 1950, on comptait 200 000 musulmans sur 42 millions d’habitants dans la France métropolitaine, soit 0,4 % de la population. En 2014, on en compterait 6 millions sur près de 67 millions, selon les projections les plus couramment acceptées, sur près de 67 millions, soit 8,9 %. Mais une enquête menée en 2015 par une équipe CNRS/Sciences Po Grenoble et publiée le 4 février 2016 par L’Obs, révèlait, chez les collégiens des Bouches-du-Rhône, 25,5 % de musulmans. Ce qui implique nécessairement une natalité beaucoup plus forte dans les familles musulmanes que dans les familles non-musulmanes. La même enquête indiquait également que si 40 % seulement des collégiens non-musulmans attachent de l’importance à la religion, la proportion montait à 83 % chez les musulmans. Le directeur de l’enquête, Sébastian Roché, notait que ces chiffres étaient représentatifs de « la France des grandes villes », donc de la plus grande partie de la population française dans son ensemble.
A terme, au-delà du suicide démographique français des années 1970, c’est donc le risque d’un dédoublement de la population française qui se dessine : une France parfois qualifiée « de souche », non-musulmane, peu prolifique, incertaine de son identité, et une France issue de l’immigration, à dominante musulmane, très prolifique, sûre de son identité. En 1985, le député et ministre centriste Bernard Stasi, descendant d’immigrés italiens et hispaniques, croyait pouvoir qualifier l’immigration en général de « chance pour la France ». Trente ans plus tard, après les tueries de Charlie Hebdo, de l’HyperCacher et du Bataclan, la majorité des Français est de l’avis contraire.
Selon un sondage Ifop/Valeurs Actuelles publié le 8 octobre 2015, 82 % d’entre eux, dont 64 % des symptahisants socialistes, souhaitent un durcissement des critères d’obtention de la nationalité française. Et selon un sondage Ifop/Dimanche Ouest-France, publié le 5 mars 2016, 59 % des Français ne veulent plus accueillir de migrants de la région méditerranéenne et moyen-orientale, à l’exception de certains cas de détresse. Parmi les raisons invoquées : la peur d’importer des jihadistes et le refus de maintenir un « appel d’air » envers des populations que l’on tient désormais pour peu assimilables.
© Michel Gurfinkiel & Valeurs Actuelles, 2016